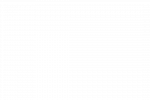Algérie : à l’université de Béjaïa, « le mouvement du 22 février a tout libéré »

Algérie : à l’université de Béjaïa, « le mouvement du 22 février a tout libéré »
Par Ryad Abdou (Béjaïa, correspondance)
Dans la capitale de la petite Kabylie, les manifestations étudiantes dénoncent, pêle-mêle, le chômage, l’islamisme et le pouvoir militaire qui a succédé au régime Bouteflika.
Des jeunes brandissent des drapeaux algériens et amazighs lors d’une manifestation contre le président Abdelaziz Bouteflika à Béjaïa, le 26 mars 2019. / RYAD KRAMDI / AFP
« On n’est pas spectateurs, on est tous concernés ! », entend-on, en français. Il est 10 heures, ce mardi 28 mai, sur le campus Targa Ouzemmour de Béjaïa, capitale de la petite Kabylie. Les drapeaux algériens et amazighs sont de sortie. C’est l’heure du rappel des troupes devant la bibliothèque centrale, sous un soleil déjà pesant. « Faites le tour, ramenez les gens ! », se démène Lemnouar Hammamouche dit « Nonor », 25 ans.
Militants d’extrême gauche, du Front des forces socialistes (FFS)… Toutes les nuances de l’opposition politique locale se déclinent devant l’entrée de l’édifice. Seule exception : les indépendantistes du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), qui se regroupent seuls un peu plus loin, à l’ombre. « Ils se considèrent en dehors du mouvement car c’est un mouvement algérien, national. De toute façon, les autres ne veulent pas non plus se mélanger à eux », observe un étudiant.
Les syndicats reconnus ont été balayés
Nonor, Juba, Titi, Houda et une vingtaine de leurs camarades, inscrits en droit, français, génie civil ou sport, déploient leurs banderoles et dégainent les mégaphones. Si le paysage politique local était un amphithéâtre, ils occuperaient les travées les plus à gauche. Certains ne cachent d’ailleurs pas leur sympathie, voire leur appartenance au Parti socialiste des travailleurs (PST, anticapitaliste), très actif dans la région.
Ils ont l’habitude de prendre la tête des manifestations étudiantes de Béjaïa, et même de les lancer. Créée en 2011 sur fond de contestation contre la vie chère et de mobilisation dans les facs, Savoir +, une association culturelle, fait office de syndicat étudiant. A Béjaïa, encore plus que sur les autres campus, les syndicats reconnus, comme l’Union nationale des étudiants algériens (UNEA, liée au FLN) ou l’Union générale des étudiants libres (UGEL, islamiste), ont été balayés par la révolte qui secoue l’Algérie depuis février et qui a entraîné la chute du président Abdelaziz Bouteflika.
Le Rassemblement actions jeunesse (RAJ) se partage, lui, entre comités étudiants et de villes. Le mouvement veut créer des ponts entre le campus et la société civile. Quitte à avancer à rebours du dégagisme en multipliant les rencontres, y compris avec le personnel politique : « On a invité le FFS, le RCD, le PST, le MDS, Jil Jadid et Louisa Hanoune, le 13 mai. Mais celle-ci a été arrêtée quatre jours plus tôt », explique Bissame Amroche, l’un des coordinateurs du RAJ.
Signe du nouveau rapport de forces dans l’université, les rencontres, publiques, ont lieu dans l’auditorium. « L’administration n’a pas le choix. Le mouvement du 22 février a tout libéré », sourit Bissame. « Chômage, misère, injustice… Ce sont des accumulations d’événements qui ont tout fait déborder », explique Juba. Les griefs directement liés aux conditions de vie et d’études suivent de près : « Elles se dégradent d’année en année. Et le système LMD [licence, master, doctorat] n’arrange rien. »
Près de quinze ans après le début de sa mise en place en Algérie, la réforme continue de susciter colère et mal-être. Sont cités, pêle-mêle, une inégalité d’accès aux diplômes, dont la valeur même est devenue incertaine, des défaillances pédagogiques et des ressources matérielles qui n’ont jamais suivi. Le chômage des jeunes diplômés s’envole. Bissame en sait quelque chose : enseignant vacataire à l’université, il est plus souvent au chômage que devant des étudiants.
« Un Etat civil, pas un Etat islamiste ! »
Le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap) et le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) suivent le cortège étudiant au nom d’un « collectif des enseignants et travailleurs de l’université ». Mais il n’est pas facile de mobiliser et le résultat est parfois jugé décevant comparé aux mobilisations étudiantes du mardi à Alger, où « ça descend en masse ». La chaleur et le ramadan font aussi leur effet. Après avoir convaincu deux étudiants de la rejoindre, une enseignante finit par les libérer – « c’est quand même bien d’être venu ». Agacée, elle désigne d’autres fautifs : ses propres collègues qui ont maintenu des examens.
« Il y a des examens qui commencent cette semaine, confirme Nacer, professeur de biologie, plus mesuré. Ailleurs en Algérie, des facs ont décidé de voter la grève ou le boycott. Je ne suis pas sûr que ce soit dans l’intérêt des étudiants. Ici on organise des journées, le jeudi, le vendredi, c’est mieux. » Il craint une bataille encore longue : « Nous sommes dans un système qui a tout gangrené, du sommet de l’Etat à l’université. Le gang Bouteflika est parti, le système politique s’effondre, mais il reste le pouvoir réel : les généraux, le haut commandement de l’armée. »
Son inquiétude ne déteint pas sur la bonne humeur revendicative du défilé, qui s’élance sur les trois kilomètres de boulevard qui le séparent de la place Saïd-Mekbel, du nom d’un journaliste assassiné pendant la décennie noire. « Dis à Gaïd de ne pas pleurer, le 4 juillet je n’irai pas voter », chante-t-on (en arabe) en référence au général Ahmed Gaïd Salah, l’homme fort du pays, et sur l’air de Menfi, un chant populaire repris en France par Rachid Taha, auquel répondent les classiques « C’est une république, pas une caserne », « Un Etat civil, pas un Etat militaire », et sa variante locale : « Un Etat civil, pas un Etat islamiste ».
Aidée par l’absence de tout uniforme policier – une autre constante locale –, cette ambiance est vite mise à mal quand l’annonce du décès de Kamel Eddine Fekhar parcourt les rangs. Emprisonné depuis le 31 mars, ce militant des droits humains, défenseur de la minorité mozabite (des Berbères de rite ibadite), est mort mardi après une grève de la faim. Un « crime » qui ici convoque d’autres morts. Ceux de 2001, quand la Kabylie s’était embrasée après la mort d’un lycéen tué dans une gendarmerie. La répression avait fait 128 victimes.
La colère n’est jamais retombée, pas plus que les slogans d’alors n’ont été oubliés. Les « Dégagez » d’aujourd’hui s’effacent alors devant les « Pouvoir assassin » d’hier, au fur et à mesure que les manifestants s’approchent du lieu de dispersion. Les appels à manifester vendredi dédient au militant décédé le prochain défilé.
Les vacances d’été, un crève-cœur
A l’université règne une atmosphère particulière. Sur cet imposant campus (près de 50 000 étudiants), aucun agent de sécurité ni membre des forces de l’ordre n’est en vue. La franchise universitaire s’étend même aux non-jeûneurs : il n’est pas compliqué de se rafraîchir ou de griller une cigarette. Dans le local de Savoir +, une affiche dénonçant les violences faites aux femmes accueille le visiteur. Houda décrit une fac où les étudiantes ont pris l’habitude de prendre la parole dans les assemblées générales. « Contrairement aux autres universités, ici on ne voit pas de forme de sexisme… Ce n’est pas le cas dehors », s’empresse-t-elle d’ajouter.
A Béjaïa comme ailleurs, l’irruption des femmes et de leurs revendications dans les rues n’a pas plu à tout le monde. « Lors de la treizième marche du vendredi, début mai, quand on a déployé une banderole réclamant l’égalité hommes-femmes et l’abrogation du code de la famille, on a rencontré de l’hostilité. On nous disait : “Ce n’est pas le moment de mettre en avant ce type de revendications”. Cela s’est passé le 8 mars aussi. Mais à Béjaïa, on a continué de défiler », souligne la jeune femme.
Pour les jeunes mobilisés, l’heure est à la réflexion sur la structuration du mouvement. « Nous voulons construire un syndicat étudiant au niveau national. Ça bouge un peu partout et nous essayons de nouer des contacts avec tout le monde pour organiser une coordination nationale, ce qu’on n’est pas parvenu à faire jusqu’ici. Ce sera pour la rentrée prochaine », regrette Nonor. Il leur faudra laisser passer un été qui s’annonce mouvementé, alors que la mobilisation étudiante a été un moteur du soulèvement. Les vacances à venir sont un crève-cœur. Le mot d’ordre n’est pas « vivement la rentrée », mais c’est tout comme.