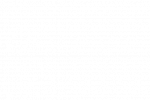Rock : Tame Impala offre à We Love Green un flamboyant final psychédélique

Rock : Tame Impala offre à We Love Green un flamboyant final psychédélique
Par Bruno Lesprit
Le groupe australien a donné en clôture du festival de Vincennes un concert hypnotique.
Franchement, la présence, dans la soirée du samedi 2 juin, de Booba en tête d’affiche de We Love Green relevait de l’incongruité programmatique. Que faisait donc le « Duc de Boulogne » au Parc floral de Vincennes, le roi du bling-bling et chantre de l’hyperconsommation (bagnole, flingues et toute la quincaillerie) dans un festival bien sous tous rapports, écoresponsable et proposant des rencontres autour de la protection de l’environnement animées par le service Planète de ce journal ? La question ne s’est heureusement pas posée, le lendemain, en clôture, avec la venue de Tame Impala, formation aux antipodes du rappeur à clashs.
A commencer par le son : après les machines cheap et toc, la voix en autotune automatique, place à une superproduction sensorielle qui justifiait les 70 euros dépensés par les festivaliers pour la journée. Certains artistes profitent peut-être de leurs cachets pour agrandir leur parc de cylindrées, le quintette de Perth (Australie-Occidentale) investit à l’évidence des sommes conséquentes dans son équipement et son dispositif scénique. La spatialisation sonore et les lumières renouent avec les grandes heures de Pink Floyd, la référence historique dans ce domaine, avec des images convoquant les visions futuristes du collectif de designers Hipgnosis, bien connu des nostalgiques du rock progressif.
En ce dimanche, on pourra dire que Jay Watson n’a pas chômé. Avant d’officier dans la nuit comme claviériste et guitariste de Tame Impala, le musicien s’est présenté sous un cagnard digne de l’outback australien sur la scène dite de La Canopée. En ajoutant à ses fonctions celle de bassiste pour Pond, projet siamois du groupe phare du néo-psychédélisme. L’explication est simple : les deux ensembles, apparus en 2008 dans une des métropoles les plus isolées du monde, n’ont cessé d’échanger leurs membres, mais seul Jay Watson continue aujourd’hui d’œuvrer pour les deux. Le chanteur de Pond, Nick Allbrook, fut bassiste de Tame Impala jusqu’en 2013, avant de se consacrer pleinement à son rôle de leader.
Les deux entités cultivent une évidente parenté musicale : usage massif de synthétiseurs, utilisés avec légèreté, comme pour traduire une indolence balnéaire, sons ludiques sortis de jeux vidéo, beats hypnotiques hérités de la culture électronique. Ce psychédélisme 2.0 a été parfois décrit (et moqué) comme un psychédélisme sans les hallucinogènes. Nourri non au space cake et aux buvards lysergiques, mais au carrot cake et aux jus de fruits bio, donc idéal dans le cadre de We Love Green. Le premier groupe de Nick Allbrook s’intitulait Electric Blue Acid Dogs, mais il a dû en changer le nom parce que la référence au LSD – qui n’était peut-être qu’une allusion plus innocente à l’acid rock des années 1960 – lui attirait de sérieux ennuis avec les programmateurs.
Feu d’artifice mélodique
Ce qui ne risque pas d’arriver à We Love Green : Jay Watson est dans le tempo en portant un tee-shirt à la gloire de la planète verte, quand les chansons du huitième album (en dix ans) de Pond (« étang ») traitent de thématiques communes au think tank du festival : l’eau et la défense des cultures aborigènes, avec un single, Daisy, tourné sur les terres des nations kulin et nyoongar, auxquelles Pond exprime sa « respectueuse reconnaissance ». La musique s’éloigne des voyages interstellaires de Tame Impala, privilégiant un funk blanc, rappelant celui d’INXS et s’amusant d’une reprise de la « grande Madge » (Madonna) : un Ray of Light de circonstance sous 30 °C, qui n’empêchent pas Allbrook de jouer son numéro de showman aux poses jaggeriennes.
Kevin Parker, son alter ego de Tame Impala, est, lui, plutôt une créature de la nuit, une silhouette noyée sous les jeux de lumière. Son collectif a pour originalité de n’en être un que sur scène, lorsqu’il recrée les chansons du démiurge chevelu-barbu et multi-instrumentiste, dont on attend le quatrième album après le carton planétaire de Currents (2015), écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Annoncé pour cet été, l’objet n’a toujours aucune date de sortie, et rien n’en aura été dévoilé pour cette seule date française estivale, sinon les deux singles livrés en guise de teaser : Borderline et Patience, deux titres qui évoquent la période disco des Bee Gees, fratrie originaire de l’île de Man avant de migrer à Manchester puis Brisbane (Queensland). Kevin Parker avait fait une déclaration remarquée en affirmant que l’origine de Currents était l’écoute de Stayin’Alive sous l’emprise de champignons et de cocaïne. Il n’est pas certain qu’il fallait l’entendre au premier degré.
Patience il faut donc prendre en profitant de la beauté hypnotique d’un show graphique et d’une musique qui réussit l’exploit de fédérer dans un même élan du cœur Supertramp (idolâtré par Kevin Parker, qui a pris modèle sur les fragiles aigus de Roger Hodgson), les coups de caisse claire métronomiques de la Motown (Apocalypse Dreams), les embardées cosmiques de Flaming Lips ou le glam-rock façon T. Rex (Elephant). Après un week-end passé à entendre – comme partout ailleurs – beaucoup de sons programmés et de boîtes à rythme, le plaisir est immense à communier avec un groupe jouant de la dynamique et des contrastes, de la compression comme de l’explosion dès Let it Happen, prélude à un feu d’artifice de couleurs mélodiques et rythmiques. La dantesque ligne de basse cinglée de The Less I Know the Better ou l’élégiaque sucrerie de Love/Paranoia confirmant que Currents est bien un des disques les plus sensibles et aboutis de la décennie, attisant davantage le désir d’en connaître la suite.