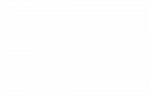Au Cameroun, le calvaire des déplacés des régions anglophones

Au Cameroun, le calvaire des déplacés des régions anglophones
Par Josiane Kouagheu (Douala, correspondance)
Le conflit au Cameroun anglophone (1/5). Depuis bientôt deux ans, des groupes séparatistes affrontent les forces armées camerounaises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les civils paient le prix fort
De nombreux Camerounais fuyant les affrontements entre les séparatistes et les forces armées trouvent refuge à Douala, la capitale du pays, ici en 2013. / JOE PENNEY / REUTERS
Il fait nuit à Bonabéri, un quartier ouest de Douala, la capitale économique du Cameroun. Une jeune fille, vêtue d’un mini-short et d’un débardeur moulant, rejoint un groupe de femmes installées dans la pénombre, près du bar « Kwassa-kwassa ». Dès qu’un homme passe, commence le jeu de charme pour espérer « gagner » un client. « Ce sont des enfants », s’indigne Sylvestre, un chauffeur de taxi. « Depuis que la guerre a éclaté en zone anglophone, elles sont nombreuses ici », lui répond un vendeur ambulant.
Quelques jours plus tôt, Tity (prénom changé à sa demande), 16 ans, l’une de ces jeunes filles, expliquait « se prostituer pour survivre ». Après sa fuite de Kumbo, ville du nord-ouest, l’ancienne collégienne est arrivée avec sa mère et ses frères, fin juin 2018 à Douala. « On fuyait les balles, la mort », dit-elle, un peu perdue, sans nouvelle de son père et de son oncle.
En raison du conflit armé qui oppose depuis deux ans les séparatistes réclamant l’indépendance du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les deux régions anglophones du Cameroun, aux forces de défense et de sécurité camerounaises, 530 000 personnes se sont réfugiées dans les forêts environnantes et dans les régions francophones, selon l’ONU.
D’après Human Rights Watch, les forces gouvernementales ont tué, dans « une impunité quasi-totale », de nombreux civils, incendié des centaines d’habitations et recouru à la torture contre des personnes soupçonnées d’appartenir à des groupes séparatistes. De leur côté, souligne l’ONG de défense des droits de l’homme, les « Amba Boys », en référence à l’« Ambazonie », la république indépendante pour laquelle ils se battent, ont tué des centaines de soldats et de policiers, agressé et enlevé des centaines de personnes.
Trois crises majeures
« Il y avait des morts. Des militaires tiraient. Ce n’est que dans les films que j’avais vu autant de corps », se souvient Tity. A Douala, ces hommes, femmes et enfants, sans repères, manquent de tout : vivres, eau et assainissement, abris, moyens pour se soigner.
Selon l’ONG Norwegian Refugee Council, le Cameroun vit actuellement la crise « la plus délaissée au monde ». L’ONU évoque une situation humanitaire « d’urgence » et estime que le Cameroun, en proie à trois crises majeures – la lutte contre Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord, la situation des réfugiés centrafricains dans l’Est et la crise anglophone – a besoin de 300 millions de dollars pour assurer l’assistance humanitaire. A peine 21 % des fonds ont pu être récoltés jusque-là.
« Vu le sous-financement, les Nations unies ont décidé de débloquer 11 millions de dollars de ses fonds propres », précise Allegra Maria Del Pilar Baiocchi, la coordonnatrice des Nations unies au Cameroun. « Aujourd’hui, le défi principal, ce sont les ressources financières », soupire celle qui multiplie les plaidoyers pour attirer l’attention sur la situation « invisible » que traverse le pays. Car, si rien n’est fait, prévient Mme Biocchi, il faudra « prioriser » les besoins et « sacrifier certaines activités ».
A Douala, les déplacés se débrouillent comme ils peuvent. Certaines, comme Tity, se sont tournées vers la prostitution. Au début, elle et sa famille étaient logées chez une connaissance. Puis, ils ont été obligés d’aller louer une chambre.
« Au moins de quoi acheter un petit bout de pain »
« Il faut se nourrir, se soigner… C’est dur car nous n’avons rien ni personne. C’est pourquoi j’ai choisi cette voie. C’est mieux que les balles. Ici, je suis en vie », poursuit la jeune fille au triste sourire. Certaines, plus « chanceuses », sont femmes de ménage dans des familles où elles sont logées, parfois payées en denrées pour nourrir leur famille.
Ce phénomène de domestiques « bon marché » venues des zones rurales anglophones existe depuis des décennies. Mais, avec la crise, des jeunes filles sont de plus en plus sollicitées, mal payées et maltraitées.
D’autres déplacés fouillent les poubelles à la recherche de bouteilles en plastique qu’ils lavent et revendent, tandis que d’autres travaillent dans les chantiers ou exercent toutes sortes d’activités pouvant leur donner « au moins de quoi acheter un petit bout de pain », explique l’un d’eux.
Assise à l’ombre d’un arbre, Joséphine, 65 ans, défait ses tresses et raconte avoir perdu « la joie de vivre » depuis qu’elle a quitté « comme une voleuse » Bafut, son village dans le Nord-Ouest. Elle a vu son fils adoptif, René, et celui de son voisin criblés de balles, les intestins répandus sur la route, « des innocents qui rentraient des champs et qui ont été surpris par des affrontements, des femmes aussi ont été touchées ». « Ce jour-là, nous avons pris la fuite », explique-t-elle. Pour ne pas courir le risque « d’être tous tués », la famille se sépare : le mari, les trois fils et une partie du groupe d’un côté ; elle, ses petits-fils et une dizaine de voisins de l’autre.
« Calvaire »
Joséphine et son groupe font du stop et arrivent à Malende, dans le Sud-Ouest, où ils ont de la famille. Lorsque les violences s’intensifient de ce côté, la brousse devient le seul refuge. Ils y sont plusieurs centaines dans ce qu’ils appellent « le camp ». Ils dorment à même le sol sur des feuilles, se font piquer par les moustiques et passent des jours sans manger. « Je n’ai jamais vu une telle souffrance de toute ma vie », s’indigne Joséphine en plissant son visage ridé.
En août 2018, certains déplacés parviennent à faire venir des conducteurs de mototaxis jusqu’au « camp ». Ces derniers leur proposent leur service : 15 000 francs CFA, soit plus de dix fois le prix habituel, pour rejoindre un endroit où ils pourront emprunter un véhicule pour Buea, la capitale régionale du Sud-Ouest.
Joséphine fait le choix de ne prendre que ses petits-enfants et abandonne les autres membres de sa famille. « Je n’avais plus d’argent. J’ai laissé une jeune sœur qui venait d’accoucher. C’était dur », relate-t-elle. Après un premier arrêt à Buea, elle se réfugie finalement à Douala en août 2018, chez l’un de ses fils.
Dans la capitale économique, trouver de quoi manger est un « calvaire ». La vieille cultivatrice, qui se souvient de son champ à Bafut, gagne quelques sous en tant qu’ouvrière dans une petite plantation. Les dernières nouvelles de son mari et de ses fils remontent à des semaines. Au fil des jours, « la peur ronge [son] cœur ». « Je vis à Douala avec mon fils qui n’a pas de travail et peine à nous nourrir. Mon époux et mes fils sont en brousse et sont peut-être morts. Je suis si triste », confie-t-elle.
Les distributions bloquées par la violence
Selon l’organisation International Crisis Group (ICG), 1 850 personnes sont mortes en vingt mois de conflit. Mais selon Paul Ayah Ayah, président de l’ONG Ayah Foundation, l’une des premières à avoir fourni de l’aide aux déplacés anglophones et à ceux réfugiés au Nigeria, « de nombreux morts ne sont pas comptabilisés ». « Plus de 200 villages ont été rasés. Il y a des endroits extrêmement risqués où on ne peut se rendre. Il n’y a pas d’accès, pas d’information », indique le fils de Paul Ayah Abine, un ancien député et avocat général près la Cour suprême du Cameroun, passé dans l’opposition, un temps emprisonné. « Tant qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu, l’aide humanitaire ne pourra pas aboutir à grand-chose. Même quand nous allons distribuer des vivres dans la brousse, nous ne sommes pas sûrs de ressortir vivants », ajoute-t-il.
Le gouvernement camerounais a mis sur pied un centre pour la coordination de l’aide humanitaire d’urgence avec des bureaux à Buea et Bamenda, les deux capitales régionales. En partenariat avec des organisations humanitaires nationales et internationales, des tonnes de denrées alimentaires, matelas, ustensiles de cuisine y convergent pour être données aux déplacés.
Mais la violence bloque les distributions. Ainsi, douze tonnes de denrées transportées par le Programme alimentaire mondial ont été incendiées et détruites en juin par des groupes armés. Début juillet, Allegra Maria Del Pilar Baiocchi s’est dite « préoccupée » par les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs humanitaires pour acheminer leur aide. « Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la priorité immédiate est d’atteindre les populations des communautés rurales, qui ont été coupées des services de base. Cela ne peut se faire sans le respect et l’acceptation de notre travail », a-t-elle martelé.
Peur
Selon un officier en poste à Bamenda, les séparatistes ont ordonné à la population de refuser ces aides et affirmé que ces denrées seraient empoisonnées. « Ils sont même allés jusqu’à dire que c’est une manière pour le gouvernement d’identifier la population et de les tuer plus tard », s’emporte le militaire. Pourtant, sur le terrain, beaucoup y croient. Terrorisés à l’idée d’être considérés comme des séparatistes par les militaires ou les complices de « la République » (nom donné au gouvernement) par les combattants indépendantistes, les habitants et déplacés vivent dans la peur, que ce soit dans les zones anglophones ou les villes francophones où ils sont réfugiés. Tous ceux qui ont confié leurs histoires avaient « peur d’être pris pour des complices » de l’un ou de l’autre camp.
C’est le cas du jeune Emmanuel, 15 ans, rencontré mi-mai à la gare routière de Bonabéri. Ses deux grands frères ont rejoint les groupes séparatistes. L’un a été tué par les militaires. L’autre combat toujours. Craignant d’être « enrôlé et surtout tué », l’adolescent a marché pendant des jours avec des amis dans la forêt, par peur d’être arrêtés aux multiples barrages, faute de papiers, brûlés dans l’incendie de leurs maisons.
Dans la capitale économique, Emmanuel passe ses nuits à la gare. « Lorsque je suis arrivé, j’ai d’abord vécu avec un ami chez l’un de ses proches mais, ils n’avaient pas d’argent pour nourrir d’autres personnes alors je suis venu ici », raconte-t-il. Thomas Ndoh, président de Human Right Defense Club, une ONG locale qui vient notamment en aide aux déplacés, promet de lui trouver un abri. Mais, le lendemain et les jours d’après, l’humanitaire le cherche en vain. Emmanuel a pris peur.
« Traumatisés, les déplacés suspectent tout le monde. Ceux qui n’ont pas de pièces pouvant les identifier ont doublement peur d’être arrêtés, taxés de séparatistes ou de complices. L’apatridie est l’autre énorme conséquence de cette crise », déplore Thomas Ndoh. Une nouvelle épreuve pour tous ceux qui ont fui une partie du pays qui refuse désormais d’être camerounaise, et se retrouvent coincés dans une autre qui ne les reconnaît plus.