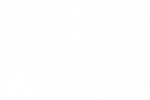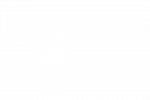Aux Seychelles, le parti Lepep forcé à une cohabitation historique après quarante ans au pouvoir

Aux Seychelles, le parti Lepep forcé à une cohabitation historique après quarante ans au pouvoir
Par Bruno Meyerfeld (contributeur Le Monde Afrique, envoyé spécial à Victoria)
Les difficultés économiques et le refus de la corruption ont fait perdre aux socialistes les législatives de septembre 2016.
Des partisans de l’Alliance démocratique seychelloise célèbrent la victoire de leur parti aux législatives, le 11 septembre 2016. | - / AFP
De ses bureaux nichés au sommet d’une tour sans âme de Victoria, James Michel peut contempler à sa guise l’Assemblée nationale des Seychelles. Mais le cœur n’y est plus : l’ex-président du pays a le regard absent. « J’ai participé à la lutte pour l’indépendance, j’ai été ministre, vice-président, président… Il était temps de passer la main », tente-t-il de se convaincre, la voix glacée.
C’est pourtant un véritable tsunami qui a poussé M. Michel, à la tête de son pays pendant douze ans, à quitter ses fonctions en octobre 2016 et à céder la place de chef de l’Etat à son vice-président Danny Faure. Le mois précédent, l’opposition avait remporté une victoire historique lors des législatives, obtenant pour la première fois la majorité des sièges à l’Assemblée nationale, face au Lepep (« le peuple » en créole), le parti qui gouvernait le pays sous des noms différents depuis 1977. Mais pour l’ancien roi des 115 îles seychelloises, le temps des regrets n’est pas encore venu. « Tout ça est le résultat d’un rejet des élites au niveau mondial. Aux Seychelles, on a une économie performante. Il n’y a pas de pauvreté. Ici, les gens sont bien », veut encore croire James Michel.
Pourtant, sous la plage, les pavés tremblent. Le pays de 93 000 habitants, plus connu pour ses tortues de mer et ses atolls que pour sa vie politique, est à un tournant. « C’est une fin de règne ! », se réjouit Jean-François Ferrari, député et leader de l’opposition, qui débarque de son bureau tout sourire, en short et sandales. « Pour moi, c’est l’aboutissement de trente ans de lutte. Pour les Seychelles c’est presque une révolution, soutient-il. C’est une transition comparable à celle de Cuba. »
Cuba ? L’île communiste, à 14 000 kilomètres, a longtemps fait rêver les Seychellois. En 1977, dix mois après l’indépendance, le pays a pris un virage socialiste, avec aux commandes pendant vingt-sept ans l’indéboulonnable France-Albert René. Sous la férule de celui qu’on appelait « Ti France », l’économie est étatisée, la santé et l’éducation rendues gratuite, assurant une incontestable popularité aux dirigeants des Seychelles et au parti au pouvoir.
Comment alors expliquer la défaite ? « Malgré l’introduction du multipartisme en 1993 et le passage du pouvoir à James Michel en 2004, la machine s’est essoufflée. Les gens en ont marre de la langue de bois, du manque de liberté et de la corruption », explique Jean-François Ferrari. La seule chaîne de télévision est contrôlée par l’Etat, et, dans ce paradis fiscal comptant deux fois plus de société offshore que d’habitants, la collusion est totale entre le milieu politique et celui des affaires.
L’amère potion de la « politique ultralibérale »
« Mais aux racines de la désaffection entre le pouvoir et la population, il y a la crise économique de 2008 et la politique ultralibérale menée depuis », rappelle un journaliste en poste à Victoria, qui souhaite rester anonyme. Le pays est alors en quasi-faillite. Sa dette publique dépasse les 150 % du PIB. Pressé par le Fonds monétaire international, l’Etat licencie des centaines de fonctionnaires, vend ses monopoles et dévalue la roupie seychelloise, qui perd la moitié de sa valeur face au dollar. Dès 2010, la dette baisse de moitié et la croissance rebondit à plus de 6 %.
Pour les Seychellois, la potion est amère. Dans ce pays dépendant de la pêche et du tourisme, les prix ont explosé, les inégalités ont grandi. Plus d’un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté. « Et dans le même temps, on a vu débarquer une nouvelle génération de dirigeants : des jeunes loups, appelés par James Michel au pouvoir, diplômés à l’étranger, qui pavanaient avec leurs belles voitures et leurs gros salaires », poursuit le journaliste. Un quartier, Eden Island, est construit pour ces « golden boys » : une île artificielle de 56 hectares, où s’alignent boutiques et restaurants de luxe et où les villas avec plage privée s’échangent à plus de 3 millions d’euros.
« Ils sont divisés donc ils sont creux »
Choqué par cet étalage d’argent, une partie de la population ne se reconnaît plus dans le parti au pouvoir. Elle est suivie par des dissidents de la majorité, qui fondent en 2015 un nouveau parti, l’Alliance seychelloise (LS). La même année, son leader, Patrick Pillay, ancien ministre et cadre du Lepep, obtient la troisième place au premier tour de la présidentielle et 14 % des voix. Autant de suffrages qui manquent cruellement à James Michel et le contraignent à un humiliant second tour face à l’opposant historique Wavel Ramkalawan, qu’il ne remporte qu’avec 193 voix d’avance. En 2016, LS s’allie à l’opposition traditionnelle au sein de l’Union Démocratique Seychelloise (LDS) et gagne les législatives.
Même si Danny Faure peut légalement se maintenir jusqu’en 2020, l’opposition est donc aux portes du pouvoir. Mais avec quel programme ? Les opposants rejoignent bien souvent le gouvernement dans sa politique contre le changement climatique ou pour maintenir les Seychelles comme paradis fiscal. « Ils sont divisés donc ils sont creux. C’est une alliance contre nature entre des nostalgiques du socialisme et des libéraux », soupire un diplomate en poste à Victoria.
« On peut enfin s’envoler, ou bien… »
« On a autant gagné grâce à l’image négative du Lepep que grâce à nos propositions », reconnaît Jean-François Ferrari. C’est surtout dans la lutte contre la corruption que l’opposition est attendue. « Mais je doute qu’elle y change quoi que ce soit. Elle-même profite à plein du système », se désole Jean-Paul Isaac, journaliste indépendant seychellois, qui cite le cas de Patrick Pillay, soupçonné de transactions immobilières avantageuses avec l’Etat alors qu’il était ministre dans les années 1990.
Malgré tout, chacun le reconnaît : une page se tourne. Comme un symbole, James Mancham, éphémère premier président du pays (1976-1977), renversé par France-Albert René et longtemps exilé, s’est éteint le 8 janvier à l’âge de 77 ans. Quelques semaines avant sa mort, le patriarche confiait au Monde que « nous sommes à la croisée des chemins. On peut enfin s’envoler et devenir l’étoile la plus brillante de l’océan Indien ou nager très profond dans l’océan de la médiocrité ».