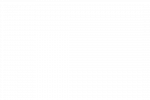Erik Orsenna: « N’oublions jamais qu’une langue est un cadeau ! »

Erik Orsenna: « N’oublions jamais qu’une langue est un cadeau ! »
LE MONDE DES LIVRES
Ecrivain, voyageur et académicien, Erik Orsenna porte une passion à la langue française. Parrain de la nouvelle collection du « Monde », « Les Petits Guides de la langue française », il explique pourquoi la langue nous construit et de quelle manière sa complexité nous nourrit et nous ouvre à l’avenir.
Amoureux et compagnon des mots, écrivain, voyageur et académicien, Erik Orsenna porte sur le français un regard nourri de passion. Parrain des « Petits Guides de la langue française », il dévoile une complicité intime et enjouée, rigoureuse et omniprésente, qui, depuis l’enfance, le lie au langage, à ses formes, à son sens et à son histoire. Exploration desarcanes de l’écrit.
De romans en récits, de conférences en ateliers d’écriture dans les collèges, vous clamez votre passion pour la langue française. D’où vient cet attachement ?
Nous touchons là au cœur de ma vie. Dans mon enfance, ma mère venait, le soir, me raconter l’Histoire de France. Mon père, lui, s’asseyait au bord de mon lit pour m’embarquer en mer dans des aventures de pirates, de frégates, de remorqueurs. Leurs voix et leurs mots m’ont bercé, nouant entre la langue française et l’enfant que j’étais un indéfectible lien, affectif et affectueux, maternel et paternel. Tous deux, bien que peu mélomanes, avaient une passion pour la chanson et m’y ont initié. Je connaissais par cœur La Complainte du petit cheval blanc, poème de Paul Fort, que Georges Brassens a mis en musique. Les premiers titres de Léo Ferré, particulièrement « Ce sont amis que vent emporte », reprenant les vers de Rutebeuf,datant du XIIIe siècle, résonnaient dans la maison. Poésie, musique, sentiments se conjuguaient au plaisir d’écouter des chansons, dans les cabarets et les salles de spectacle où mes parents m’emmenaient. A cette époque, j’avais entre 8 et 10 ans, j’ai réalisé que chaque mot est une histoire. Je commençais à écrire ; un moyen sûr pour continuer à me blottir dans les bras de ma mère et de mon père. J’ai alors compris que raconter, c’est se faire aimer.
Est-ce seule l’atmosphère du cocon familial qui vous a ouvert à la poésie et à la littérature ?
A mon entrée en sixième, deux mystères m’ont fasciné : la grammaire et le latin. Comme Tintin, dont je dévorais les aventures, j’étais animé d’une curiosité gourmande. La langue se présentait à moi comme une énigme à résoudre, une grille de lecture souterraine à décoder, un palimpseste vieux de treize siècles à déchiffrer. Au fond, chaque phrase est une version latine, dont il faut saisir le sens, découvrir la relation établie entre les mots. C’est une famille, avec ses parentés, ses fratries, sa généalogie. Aussi, pour moi, la langue détermine tout autant un espace profondément personnel qu’un lieu de savoirs, avec sa rigueur et sa structure. Avide de tout comprendre, au risque de m’éparpiller, j’ai besoin, pour ne pas perdre pied, de la rigueur stricte de règles – en somme un outil de liberté. La grammaire, la comptabilité – objet de ma thèse –, l’économie, les sciences en font partie. Aussi, le squelette de la langue, l’évolution du vocable m’ont conforté enfant dans l’apprentissage du français. Chaque fois que je me trompais, ma mère me reprenait, m’expliquait le sens des mots, sans flou, sans approximations.
Académicien depuis 1998, trouvez-vous notre langue trop complexe ?
La complexité, c’est la précision ! De ce point de vue, la cuisine est très comparable à la langue. L’une comme l’autrepeuvent être rustiques, raffinées, savantes, minimales ou indigestes. On peut même se nourrir de pilules et ne s’exprimer qu’avec 200 mots. Mais que deviennent les nuances, les subtilités, les saveurs ? Parvenus au XXIe siècle, nous voudrions vivre éternellement dans un monde totalement simplifié, au risque d’appauvrir, voire d’effacer tout ce qui en fait l’intérêt et la diversité. J’ai eu la chance que mes parents soient mes premiers guides. Ils m’ont directement inculqué ce que d’autres – auteurs, grammairiens, lexicologues, linguistes – transmettent dans les livres.
L’intérêt d’une collection comme celle des « Petits Guides de la langue française » du Monde est de réunir des spécialistes tels Roland Eluerd, Pascale Cheminée, Jean-François Sablayrolles ou Marie-Laurentine Caëtano, qui, à l’inverse de simplifier, éclairent, étonnent, soulignent, déplient, pour expliquer la complexité de la langue. Des pièges de l’orthographe aux règles de conjugaison, de l’histoire des mots aux anglicismes… tous nous disent que la langue, c’est la vie !
Les réformes de l’enseignement et de l’orthographe étaient-elles une nécessité ?
Je souscris à la vision logique des linguistes qui, au lieu de ne se référer qu’au bon usage, abordent la langue comme un « attrape-tout ». Cette approche est à l’exact opposé d’une forte et néfaste tradition de l’inspection générale de l’éducation nationale qui veut retirer à la langue sa sensualité, son contexte, détaché du savoir des parents. On y retrouve une folle pensée de la Révolution française qui voulait qu’on « libère » les enfants de leur famille pour en faire des citoyens. Dans l’enseignement du français, on a « technicisé », desséché, disséqué la langue au détriment de la pratique, en privilégiant le commentaire. Alors que l’une et l’autre sont nécessaires. Quel besoin avait-on de remplacer le terme sujet-verbe-complément par le mot prédicat ? Cette posture participe d’un puritanisme dogmatique et d’une abstraction tant sociale que politique.
Pour ce qui concerne la réforme de l’orthographe, le redoublement des consonnes ou la mutation d’accents graves en aigus ne me pose aucun problème, mais il faut s’accorder sur les règles. Un toilettage raisonnable peut être bienvenu tant qu’il n’altère ni le sens ni la grammaire. Par exemple, le circonflexe peut parfois disparaître s’il n’est pas un vestige balisant le sens d’un mot. En ancien français la lettre « s » des mots « teste » ou « hospital » avait une origine latine. Puis cette lettre a disparu, remplacée par l’accent circonflexe, devenant ainsi « tête » et « hôpital » utilisés à l’heure actuelle. Perdre cette trace, c’est amputer un mot de son histoire. Et l’histoire est un être vivant !
Dans sa mission d’enrichissement du dictionnaire, l’Académie française est-elle en phase avec les mutations de la langue ?
Contrairement à ce que l’on pense, l’élaboration du dictionnaire n’est jamais terminée, c’est un travail circulaire et continu. Dans le but de compléter le rôle de l’Académie et d’instaurer une relation plus directe et interactive avec le public, un onglet sur le site Internet de l’Institut, « Dire, ne pas dire », a été créé par Yves Pouliquen. Les mots y sont précisés et expliqués. Les internautes peuvent y échanger avec les membres de l’Institut.
Quant au travail traditionnel de la commission du dictionnaire, je me souviens d’un terme qui pendant trois séances a tenu en haleine l’auditoire sous la Coupole. Nous évoquions le mot « race ». Pierre Nora en a exprimé la vision historique que Jean-Denis Bredin a complétée au regard du droit. François Jacob a développé un point de vue biologique, puis Jacqueline de Romilly s’est penchée sur la notion d’étranger. Après l’intervention de Jean d’Ormesson, la conclusion fut impartie à Claude Lévi-Strauss dans un silence affectueux et respectueux. Chacun avait ainsi formalisé les différents apports dont ce mot a bénéficié et j’avoue que, pour rien au monde, je n’aurais cédé ma place à cet instant. Un seul mot peut engendrer de nombreux allers-retours et séances de commission.
Il en va comme des chefs-d’œuvre, chaque génération en livre sa lecture. Récemment, lors de la visite du président d’Allemagne, la séance s’est articulée autour du thème du romantisme décliné sous la plupart de ses aspects en Allemagne, en musique, en littérature, en politique. Doit-on ou non le relier à l’Antiquité ? Fut-il une lutte contre l’esprit des Lumières ? Tous ces débats sont traduits dans chaque relecture du dictionnaire. Chaque mot est donc bien une fenêtre, un roman. D’ailleurs, si je devais partir sur une île déserte et ne choisir qu’un livre, j’emporterais un dictionnaire, la matrice de toutes les histoires.
L’étendue et la maîtrise du vocabulaire permettent-elles de policer la pensée, de favoriser un regard plus affûté, une compréhension plus aiguë de ce qui nous entoure ?
Ce n’est pas tant l’étendue du vocabulaire qui nourrit la pensée mais plutôt sa justesse et, une fois encore, sa précision. A douze ans, je lisais Victor Hugo et Alexandre Dumas, à treize, Jean Racine. Je constatais qu’en peu de mots le théâtre racinien parvenait davantage à m’émouvoir et à trouver écho en moi. Ses vers tiennent de la marqueterie. La place des mots y est primordiale. De même, Aragon m’a confirmé qu’un mot, une ponctuation, comme une touche de couleur ou une note de piano, ne sont jamais là par hasard. Dire par exemple : « Au loin, un phare de voiture » est banal, mais « Un phare, au loin, de voiture », c’est déjà une musique. Ou « Venez manger les enfants ! » et « Venez manger, les enfants ! » évoquent deux « dîners » bien différents.
Nuances et subtilités de langage sont-elles finalement notre propre reflet ?
« Les hommes ont inventé la littérature, mais la littérature le leur a bien rendu », écrit Denis de Rougemont. Miroir de nous-mêmes, les nuances sont notre invention. Et quand Paul Valéry demande : « Que serions-nous sans le secours de ce qui n’existe pas ? », le poète célèbre l’imaginaire, sans lequel amour, science, politique ne sont rien. Car, s’agrégeant de siècle en siècle, les subtilités nous construisent. Chaque terme appelle ses distinctions. Obstination et volonté sont frères mais pas jumeaux. De même l’amour n’est ni l’inclination ni le penchant… Vladimir Jankélévitch, dont j’ai suivi l’enseignement, reprenait dans son cours son Traité des vertus, définissant les notions de courage, d’attention, de fidélité… Puisant dans une sorte de magma général, lephilosophe et musicologue partait de l’origine des mots et de leurs variantes pour nous dire qui nous sommes.
J’ai éprouvé la même fascination à la lecture des premières pages de la Genèse, pour la logique stupéfiante qu’elles portaient : en nommant, on distingue. En distinguant, on crée. A partir du flou originel, nommer, c’est créer. Soudain surgit une phrase très simple et si mystérieuse : « Et le verbe s’est fait chair »… J’ai essayé de la mettre à profit dans ma vie sentimentale…
Si une langue véhicule une vision du monde, traduit-elle l’identité d’un peuple ?
Non seulement elle en dépeint l’identité, mais je pense qu’elle la forge. Une langue se construit sur un socle, évolue de rapprochements en règles, intégrant aussi certaines libertés prises à leur égard. Le français s’est formé au fil de près de quatorze siècles, avec une base latine et nombre d’apports réguliers, puis au fil du temps tout le monde a ajouté sa pierre à l’édifice, de François Villon aux brèves de comptoir, des rois aux chanteurs, des hauts fonctionnaires aux écrivains… On dit que Cervantès a fixé l’espagnol, Dante, l’italien, Luther, l’allemand, mais le français s’est nourri de contributions très diverses, notamment grâce à la Pléiade et à Rabelais.
Ainsi, La Fontaine et Racine, qui étaient cousins, nous offrent une langue qui tend à l’économie et, avec si peu de mots, dit l’essentiel. En revanche, Chateaubriand, Hugo et Proust l’inscrivent dans un flux généreux, expansif, enthousiaste. Au panthéon des grands stylistes, c’est-à-dire ceux dont l’expression est la plus riche et dit le plus, je placerais Racine, La Fontaine, Buffon, Stendhal, mais aussi Proust et Céline auxquels j’ajouterais Marot, Verlaine et Aragon. Ces grands auteurs illustrent la diversité de la langue à l’intérieur d’une même famille de regards. Je crois que la république (au sens latin de res publica, la chose publique), c’est notre langue, cet usage que nous avons en commun, en partage, comme l’a si bien écrit Maurice Druon dans sa Lettre aux Français sur leur langue et leur âme. A ce titre, les Français ne sont pas propriétaires de leur langue. En Suisse, en Belgique, au Québec, en Afrique… les apports de la francophonie la nourrissent. Cette verbo-diversité, bien à l’image de la langue et du peuple qui la parle, dépasse l’idée de nation.
Comme la francophonie, le rap et le slam participent-ils à l’enrichissement du français ?
Par la musique et la chanson je me suis ouvert à la poésie. Rap et slam en sont des vecteurs évidents. J’ai collaboré avec joie et fierté au dernier album de Grand Corps Malade, Il nous restera ça, en écrivantL’Ours blanc. Et je forme également le projet de travailler avec le rappeur d’origine malienne Oxmo Puccino, qui lui-même se définit comme un chansonnier. Dans la chanson comme dans la poésie, n’oublions pas ce que nous devons à l’étranger, aux Belges, de Brel à Stromae, au continent africain, de Léopold Sédar Senghor à Amadou Hampâté Bâ, aux Ultramarins, d’Aimé Césaire à Joseph Zobel… Le français se nourrit de leurs apports. Si la vitalité de la langue est liée au dynamisme économique, la francophonie est pour la France une chance. Le danger réside dans l’effondrement éventuel du système éducatif africain. S’il s’écroule, la francophonie y perdra beaucoup.
La langue française est-elle polluée ?
Comme l’explique le linguiste Bernard Cerquiglini, on n’a jamais autant parlé français en France qu’aujourd’hui. Au moment de la conscription de 1914, une majorité d’hommes ne se comprenaient pas. Ce qui me semble plus inquiétant est le remplacement sans raison d’un mot français par un terme anglais qui sonne plus international, voire plus chic (« smiley » pour « sourire », par exemple). Contrairement à une vision mercantile, on ne vient pas à Paris parce que la capitale est internationale mais parce qu’elle est différente. Or, en utilisant un anglais de remplacement, en tentant de faire du différent, on fabrique de l’homogène bas de gamme. C’est une erreur économique en même temps qu’une stupidité, une vulgarité et une paresse. Comme le disait Segalen : « Le divers décroît. Là est le grand péril terrestre. » La verbo-diversité diminue au fur et à mesure que les langues disparaissent. Quant aux Anglais, ils sont aussi inquiets que nous le sommes car ce qui émerge avec le globish (anglais global simplifié) n’est qu’un ersatz de leur langue, peu intelligible, y compris pour eux.
Textos et courriels sont-ils des signes d’une nouvelle ère de l’écrit ?
Il y a toutes sortes de modes d’écriture, du verlan à l’argot, auxquels la collection des « Petits Guide de la langue française » consacre plusieurs chapitres. Cela signifie que la maîtrise de la langue, voire des langues françaises est essentielle. Que les SMS et courriers électroniques signalent une permanence de la communication écrite est indiscutable. Mais quel français parle-t-on ? Un petit Français sur cinq ne manie pas correctement la langue en sixième. Face à cette urgence, l’obligation de moyens a montré ses limites. J’attends du prochain gouvernement qu’il ait une obligation de résultat dans ce domaine. Il est impensable qu’à 12 ans des enfants soient exclus de la République. Un cinquième de la population des jeunes, c’est un immense gâchis et une grande injustice. La cause républicaine est donc avant tout linguistique. Et n’oublions pas la formule d’Alain Bentolila : « Les mots font l’économie des poings. »
Quelle menace pourrait peser sur le français dans le monde, et comment la contrer ?
Aucune langue n’est à l’abri du préhumain ni du postlangage. Les fake news, les faits alternatifs en témoignent. Un président qui communique par Tweet et pense en 140 signes en est l’indice. Quand on parle n’importe comment, on devient n’importe qui. Pourtant, il suffit d’explorer nos langues pour s’en préserver, comme on monte au grenier chercher de vieux vêtements oubliés, comme on se livre enfant à une chasse au trésor. La langue est notre patrimoine immatériel, celui que l’on emporte toujours avec soi.