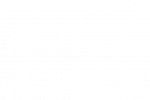A Toumour, dans le sud du Niger, comment soigner sous la menace de Boko Haram ?

A Toumour, dans le sud du Niger, comment soigner sous la menace de Boko Haram ?
Par Seidik Abba (Toumour, Niger, envoyé spécial)
Retour à Diffa (3/5). La petite équipe du Centre de santé intégré de la ville a vu exploser ses consultations en deux ans avec les vagues successives de réfugiés.
A Toumour, toute petite ville à 1 500 km au sud-est de Niamey, la capitale nigérienne, le nombre d’habitants pris en charge par le Centre de santé intégré (CSI) a augmenté de 200 % en moins de deux ans, passant de 11 000 à 32 000 personnes.
Nous sommes à 7 km seulement de la frontière avec le Nigeria et à environ 25 km de Bosso, sur la ligne de front de la guerre implacable que mènent les armées du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad contre le mouvement extrémiste nigérian Boko Haram.
Des milliers des personnes, apeurées, menacées, se sont réfugiés à Toumour et ont besoin d’une prise en charge médicale régulière. Mais ce n’est pas tant l’afflux des malades que la crainte d’un attentat-suicide commandité par Boko Haram qui effraye la petite équipe soignante dirigée par l’infirmier d’Etat Brah Hassane, « major » Hassane dans le jargon médical local.
La psychose de l’attentat-suicide
Au CSI de cette petite ville distante de 100 km de Diffa, capitale de la région est du Niger, le patient arrive sans rendez-vous et n’a pas besoin de décliner son identité, ni même de subir une fouille à l’entrée. Résultat, chaque matin, de longues files se forment dans la petite cour du centre médical, faisant craindre que des « kamikazes » envoyés par Boko Haram soient cachés parmi les patients.
« Chaque matin, c’est la peur au ventre que nous traversons les haies de 200 à 300 malades. On ne sait pas qui est qui, des éléments de Boko Haram peuvent s’y être glissés. On vit avec cette psychose », explique avec une pointe de fatalité le major Hassane.
Le major Hassane, infirmier qui dirige le Centre de santé intégré de Toumour, à 100 km de Diffa. | Ousseïni Sanda
Déjà présente depuis le mois de février 2015, date de la première action de Boko Haram sur le sol nigérien, la crainte d’une opération-suicide des partisans d’Abubakar Shekau a redoublé à Toumour avec l’arrivée il y a deux mois de la dernière vague de réfugiés nigérians.
« Ils sont restés trop longtemps dans les zones entièrement contrôlées par Boko Haram. Nul ne peut assurer qu’elle n’en a pas profité pour recruter des éléments qui peuvent commettre des opérations ici », décrypte un notable de la ville qui a requis l’anonymat.
Le souvenir des trois attaques pour le seul mois de septembre 2016 est encore vif dans l’esprit des habitants. Depuis, la ville est quadrillée par un impressionnant dispositif de sécurité : des gendarmes casqués, vêtus de gilets pare-balles, doigt sur la cachette, inspectent les véhicules entrant et sortant de Toumour.
Protocole strict
Pour la petite équipe soignante, l’immense défi consiste à concilier la poursuite des soins avec les impératifs de sécurité. « Chaque jour que Dieu fait, nous avons besoin de recharger notre moral, de nous dire qu’il faut rester confiants et oublier les risques », lâche le major Hassane, assis devant son bureau. La prise en charge des urgences relève, la nuit tombée, d’un protocole bien précis que les patients doivent respecter à la lettre. Quelle que soit l’urgence, le malade doit d’abord se présenter chez le chef de village ou un membre du comité de gestion. « Quand ce relais arrive à mon logement de fonction et qu’il s’annonce, je m’assure que c’est bien la voix que je connais. Alors seulement je conduis le malade au CSI. Dans aucun cas, je n’ouvre ma porte », détaille le major Hassane.
Car les assassinats avec arme blanche ou par balles n’épargnent personne. Pas même le personnel médical. Faute d’avoir pu supporter cette pression, l’adjoint du major Hassane a démissionné à la fin de l’année 2016.
A cette peur permanente s’ajoute la cadence de travail. Alors qu’elles s’achevaient à 11 heures du matin avant l’arrivée de Boko Haram, les consultations durent désormais toute la journée. Le major et sept autres personnes travaillent à flux tendu. Avec l’arrivée des vagues successives de réfugiés, un deuxième poste de consultations a dû être créé. Insuffisant pour permettre au major de faire une pause déjeuner. Le chef du CSI continue de recevoir les malades assis sur les bancs métalliques dans la petite cour qui jouxte la pharmacie approvisionnée par Médecins sans frontières (MSF).
Outre la prise en charge des pathologies respiratoires liées au vent, à la poussière et à la chaleur, de la malnutrition chez les enfants et d’autres maladies « de la promiscuité », le CSI assure aussi le suivi des grossesses et les accouchements. Pas question, toutefois, pour l’équipe médicale de s’épuiser avec les cas les plus graves. « Nous ne pouvons garder ici un malade sous observation au-delà de soixante-douze heures. S’il n’y a pas d’amélioration, nous organisons son évacuation vers l’hôpital régional de Diffa », détaille un membre de l’équipe. Une évacuation pas si simple à réaliser. Il faut affréter l’unique ambulance offerte au CSI par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), tenir compte du couvre-feu en vigueur à Toumour et des risques d’attentat sur la route.
Le levier de la prévention
Pour faire face, le CSI a besoin de nouveaux bras. Mais l’Etat nigérien, confronté à sérieux problèmes de trésorerie, n’a plus les moyens de recruter du personnel médical. La collectivité territoriale, qui a déjà envoyé deux agents, est dans la même situation de précarité financière que l’Etat central.
Reste les organisations humanitaires, qui en ont déjà fourni quatre sur les huit – autant que l’Etat et la collectivité réunis. En attendant d’hypothétiques renforts, pouvoirs locaux, ONG et soignants misent sur la prévention : 200 latrines d’urgence vont être construites et 120 autres, réhabilitées par Oxfam. Un enjeu sanitaire de taille puisqu’il s’agit de permettre à environ 6 400 réfugiés de ne plus aller faire leurs besoins naturels en plein air, favorisant la propagation de maladies.
A Toumour, dans le sud du Niger, le château d’eau qui surplombe le puits creusé par l’ONG Oxfam, pour l’instant seul point d’eau potable du camp qui accueille des milliers de réfugiés qui ont fui les exactions de la secte islamiste nigériane Boko Haram. | Ousseïni Sanda
A Toumour, une course contre la montre s’est aussi engagée pour garantir l’accès du plus grand nombre à l’eau potable. Un second forage sera bientôt fonctionnel grâce à Oxfam qui a déjà mis à la disposition de la population un château d’une capacité de stockage de 50 m3 relié à deux bornes-fontaines.
Mais il faudra bien plus pour soigner les blessures physiques et morales à Toumour, meurtrie comme ailleurs dans le bassin du lac Tchad, par Boko Haram.