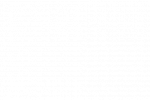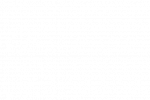La crise au Venezuela en trois questions

La crise au Venezuela en trois questions
Par Paulo A. Paranagua
Le Venezuela est plongé dans une crise multiforme et inextricable, gouvernement et opposition campant sur leurs positions et s’accusant mutuellement de vouloir perpétrer un coup d’Etat.
Le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, Henry Ramos Allup, à Caracas, le 23 octobre. | FEDERICO PARRA/AFP
La crise au Venezuela est entrée dans une impasse économique, sociale, politique et institutionnelle. Un « dialogue national » entre les représentants du gouvernement et l’opposition, annoncé lundi 24 octobre par un émissaire du pape François, a aussitôt été désamorcé, l’opposition ayant démenti la nouvelle.
Le référendum révocatoire qui devait écourter le mandat du président Nicolas Maduro a été suspendu. La commission électorale a annoncé le report vers le milieu de 2017 des élections des gouverneurs des régions, initialement attendues en décembre. Le Parlement, contrôlé par l’opposition, a approuvé mardi l’ouverture d’un procès en destitution contre le président, qui a dénoncé un « putsch parlementaire », tandis que l’Assemblée avait adopté dimanche 23 octobre une résolution qui qualifie les actes de l’exécutif de « coup d’Etat ». Une situation qui semble inextricable.
Comment qualifier la crise actuelle ?
La crise vénézuélienne est multiforme : elle est économique et sociale, car la récession et la faillite du modèle dirigiste mis en place par l’ancien président Hugo Chavez (1999-2013) provoquent de graves pénuries, alors que l’hyperinflation dilue le pouvoir d’achat des secteurs populaires et des classes moyennes.
L’impasse est aussi politique et institutionnelle, car le président Nicolas Maduro refuse de reconnaître la légitimité de l’Assemblée nationale, présidée par le social-démocrate Henry Ramos Allup. L’opposition dispose d’une large majoritaire parlementaire, tandis que le régime chaviste contrôle l’exécutif, la justice, l’autorité électorale et, bien entendu, les forces armées et la police. Des généraux et des officiers supérieurs sont aux commandes de plusieurs ministères et entreprises publiques.
La crise est également morale, car la manne pétrolière des années de hausse du cours du baril a été dilapidée par la gabegie bureaucratique et la machine de corruption mise en place par le chavisme. La plupart des dividendes du pétrole échappaient au budget et à tout contrôle.
Des sommes évaluées par l’Assemblée nationale à 11 milliards de dollars (environ 10 milliards d’euros) ont été siphonnées ou détournées. La nouvelle « boliburguesia » (bourgeoisie bolivarienne), qui a fait fortune avec le trafic de devises, l’industrie pétrolière ou minière, le narcotrafic ou encore l’achat et la vente d’armes, ne veut pas d’alternance au Venezuela.
Pourquoi le référendum révocatoire qui devait écourter le mandat du président Maduro a-t-il été suspendu ?
La Constitution ne prévoit pas d’« impeachment », c’est-à-dire de destitution du président par le Parlement et la Cour suprême, comme au Brésil ou au Venezuela dans le passé (le président Carlos Andrés Pérez avait été destitué en 1993). La Constitution promulguée par Hugo Chavez oblige dans ce cas de figure à recourir au suffrage universel, à la mi-mandat.
La sortie de crise adoptée par l’opposition était donc tout à fait conforme aux normes légales en vigueur, même si le Conseil national électoral a transformé en course d’obstacles la procédure d’obtention des signatures nécessaires (1 % de l’électorat dans une première étape, en avril, puis 20 % fin octobre).
Malgré les difficultés, l’opposition, soutenue par 80 % de l’opinion, était en passe de satisfaire à toutes les conditions, tandis que le pouvoir jouait la montre pour éviter une élection présidentielle anticipée en 2017 (au lieu de 2018). Si le référendum n’avait lieu qu’après le 10 janvier, le vice-président, qui n’est pas élu mais désigné par le chef de l’Etat, devait compléter le mandat présidentiel. Le régime espère qu’une hausse du prix du pétrole pourrait lui redonner les moyens de récupérer sa clientèle.
Cependant, vendredi 21 octobre, le pouvoir a suspendu l’organisation du référendum, ainsi que les élections de gouverneur prévues en décembre, privant ainsi les Vénézuéliens du droit de s’exprimer dans les urnes. L’opposition considère cette décision comme une rupture de l’ordre constitutionnel et un coup d’Etat. Le gouvernement Maduro ne respecte plus ni la séparation des pouvoirs ni l’Etat de droit.
Un dialogue peut-il permettre de surmonter l’impasse ?
Difficile, pour l’opposition, de s’asseoir à la table des négociations avec un pouvoir qui emprisonne ses dirigeants et élus ou en empêche d’autres de voyager à l’étranger pour dénoncer les violations des droits de l’homme devant la communauté internationale.
La médiation du Vatican, annoncée lundi 24 octobre, ne peut pas opérer de miracle, malgré l’influence du pape François. Jusqu’à présent, toutes les médiations internationales ont échoué. Sur quoi pourrait porter d’ailleurs la négociation ? L’opposition dispose seulement de la légitimité de l’Assemblée nationale, vidée de ses prérogatives, neutralisée. Elle peut difficilement renoncer au référendum, seul recours constitutionnel et pacifique pour précipiter une alternance.
D’un autre côté, le régime a toutes les cartes en main, le pouvoir économique, politique, médiatique, militaire, et ne veut pas lâcher de lest. Le président Maduro refuse même une concession symbolique, comme la libération des prisonniers politiques – ils sont une centaine, incapables de changer le rapport de forces. Les opposants sont échaudés par le dialogue de 2014 devant les caméras de télévision, qui n’a débouché sur rien. Chacun a campé sur ses positions.
Les chavistes prétendent être à la tête d’une « révolution bolivarienne », à laquelle ils ne veulent pas renoncer. Ils sont poussés à l’intransigeance par Cuba, référence de tous les nostalgiques ou illuminés des lendemains qui chantent, dépendante du brut vénézuélien à prix d’amis. Le chavisme est imperméable à la logique républicaine, il a une conception plébiscitaire et utilitaire de la démocratie. Faute de majorité électorale, le régime serre la vis. La stratégie de la tension choisie par le pouvoir est lourde de tous les dangers.