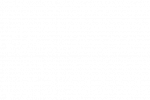Les jeunes diplômés de la finance de plus en plus tentés par l’entrepreneuriat

Les jeunes diplômés de la finance de plus en plus tentés par l’entrepreneuriat
LE MONDE ECONOMIE
Les cabinets de conseils continuent de recruter de nombreux jeunes diplômés, mais l’entrepreneuriat et l’attrait pour de plus petites entreprises sont désormais une concurrence sérieuse sur le marché des « hauts potentiels ».
Des étudiants de l’école polytechnique Paris Saclay sur le campus en février 2016. | Jérémy Barande/Ecole polytechnique
Moins qu’une tendance mais plus qu’un frémissement : après des décennies de règne, la banque d’affaire et les cabinets de conseil ne constituent plus les destinations automatiques de l’élite des jeunes diplômés de la finance.
Le doute s’est instillé en deux temps. « La crise des subprimes, en 2008, a d’abord provoqué un désamour pour les métiers de la finance de marché et un regain d’intérêt pour les métiers du conseil en stratégie, jugés moins risqués et à forte valeur ajoutée intellectuelle », explique Guillaume Sarrat de Tramezaigues, responsable du master finance et stratégie de Sciences Po, qui compte 180 étudiants parmi lesquels une quarantaine s’orientent chaque année vers les métiers du conseil. « Puis, à partir de 2013-2014, on observe un nouveau virage, très net. Les étudiants sont désormais plus intéressés par l’innovation et l’entrepreneuriat et plus attirés par les petites structures dont les réputations sont moins intimidantes », affirme-t-il.
Les responsables académiques de l’Essec, de HEC et de l’Ecole polytechnique, principaux circuits de production de consultants en stratégie, confirment, à l’instar de Laurence Lehmann-Ortega, responsable de la majeure strategic management de HEC : « Traditionnellement, en sortant de HEC, les étudiants ne se lançaient pas dans la création d’entreprise. Ils faisaient leurs armes dans les grandes entreprises. Aujourd’hui, créer une start-up dès les premières années est très valorisé. »
Une certaine inflexion
Il fut pourtant un temps, pas si lointain, où la « crème de la crème » des étudiants en finance ne se posait pas de questions. Après leurs classes préparatoires, puis leurs études dans de prestigieuses grandes écoles classées A +, ces jeunes diplômés empruntaient les voies royales autant que lucratives de la banque d’affaire ou des cabinets de conseil, de préférence en stratégie. Après quelques années de service, les jeunes consultants avaient devant eux un horizon dégagé et pouvaient notamment devenir partners (« associés ») ou rejoindre les exécutifs du CAC 40, forts d’une expérience reconnue.
L’aura des métiers du conseil ne s’est pas dissipée, comme le prouve l’enquête insertion de la Conférence des grandes écoles : en 2015, 17,4 % des ingénieurs s’orientaient vers les métiers du conseil, et 14,9 % des jeunes diplômés d’écoles de commerce. Mais les observateurs avisés de l’insertion notent une certaine inflexion dans cet engouement.
Il faut dire que, face à l’effet de mode créé par les entreprises de la Sillicon Valley, le monde du conseil semble encore très XXe siècle. Le mode de recrutement des cabinets de conseil en stratégie et en management – comme McKinsey, Bain & Company, Boston Consulting Group (BCG) – reste très normé. Plusieurs tours d’entretien, études de cas, petits exercices de calcul mental, vérifications du fit (bonne entente) avec les associés, font office de concours d’entrée dans ces prestigieux cabinets.
Le système du « up or out »
« Comme dans la haute horlogerie, nous cherchons d’excellents techniciens capables un jour d’inventer leur propre mécanisme, ce qui justifie l’exigence que nous portons au recrutement », précise Emmanuel Nazarenko, associé du BCG chargé du recrutement. A l’image de ces artisans de luxe, les cabinets de conseil perpétuent leur image prestigieuse avec la sursélection de leurs collaborateurs, de leur embauche jusqu’à leur évolution dans l’entreprise. Un monde où seuls les « meilleurs », les plus adaptés, gravissent les échelons en vertu du système anglo-saxon du up or out (promu ou évincé).
« Il faut se représenter ce qu’est un grand cabinet de conseil », dit Vincent Petitet, consultant passé par le cabinet d’audit américain Andersen, au temps de sa splendeur et avant sa chute – le cabinet d’audit fondé en 1913 et jugé coupable d’entrave à la justice dans l’affaire Enron en 2001. « Je fus d’abord sidéré par la beauté et la sobriété du bâtiment tout de verre et de métal. Les consultants étaient impeccables, des hommes et des femmes, qui allaient et venaient, vêtus de costumes sombres et élégants, de bijoux discrets et de parfum subtil. Dans ce monde-là, les signes extérieurs de richesse sont mal vus. Si l’on gagne 50 000 euros mensuels, cela ne doit pas se voir », décrit celui qui a tiré de son expérience dans le conseil un roman intitulé Les Nettoyeurs (JC Lattès, 2006).
Un contenu de cette page n'est pas adapté au format mobile, vous pouvez le consulter sur le site web
Une fois intronisés dans le petit monde de la haute stratégie, les jeunes diplômés découvrent un rythme et un fonctionnement proches de ceux des classes prépa et des grandes écoles. Une sorte de troisième cycle où les nouvelles recrues sont évaluées après chaque mission. « Il y a un conseil de classe tous les six mois, au cours duquel le chef de projet nous fait un retour et nous note sur plusieurs critères. Cette notation est assez infantilisante », remarque Zoé*, diplômée de HEC, elle-même classée dans les 20 % de hauts potentiels de son cabinet américain.
« Le conseil en strat [stratégie] me faisait rêver, j’avais l’impression que c’était un métier important avec de hautes responsabilités », raconte Pierre*, 26 ans, diplômé de l’Essec et de l’Ecole centrale, recruté dès sa sortie d’école par l’un des trois cabinets de conseil américain, qui a démissionné pour rejoindre le développement commercial d’une start-up de la foodtech. Il s’en explique, en VO : « En réalité, je n’ai pas eu de “fit” avec mes manageurs, donc je n’ai pas été “staffé” sur des missions intéressantes. » Comprendre : je ne m’entendais pas avec mes supérieurs, donc on ne m’a pas confié de missions intéressantes.
S’adapter à la nouvelle génération
Certains grands cabinets de conseil essaient pourtant de se mettre à la page, avec réorganisation des locaux à la mode californienne – salles de sport ou de sieste… –, nouveaux modes de management, missions « pro bono », congés longs, arrangements avec les manageurs sur les horaires de travail… « Nous nous sommes adaptés à cette nouvelle génération. Par exemple, les manageurs font des comptes rendus aux équipes même aux stagiaires, explique Catherine Pain Morgado, directrice du recrutement chez Bain depuis vingt ans. Cette génération est différente. Ils veulent comprendre les tenants et aboutissants de leur travail, savoir quelle est leur valeur ajoutée et leur impact. »
La concurrence avec les start-up reste toutefois à relativiser. Ainsi, Emmanuel Nazarenko rappelle que les grands cabinets de conseil fournissent une « armada » d’ex-consultants aux entreprises de la Silicon Valley. Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook n’est-elle d’ailleurs pas une ancienne de McKinsey ? Dans le monde de l’élite économique, rien ne se perd, tout se transforme.
* les prénoms ont été changés
Afin de comprendre le monde de demain pour faire les bons choix aujourd’hui, « Le Monde » vous donne rendez-vous à O21/s’orienter au XXIe siècle à Cenon (10 et 11 février), Villeurbanne (15 et 16 février) et Paris (4 et 5 mars). Entrée libre sur inscription : lemonde.fr/o21