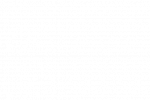De droite à gauche, tous unis pour nationaliser Saint-Nazaire !

De droite à gauche, tous unis pour nationaliser Saint-Nazaire !
Par Denis Cosnard
La « nationalisation temporaire » des chantiers navals STX fait consensus chez les politiques, face au risque d’une fuite du « savoir-faire » français à l’étranger.
Le navire de croisière « Oasis IV », en construction sur le site des chantiers navals STX de Saint-Nazaire, le 20 octobre 2016. | LOIC VENANCE / AFP
Qui aurait imaginé pareille unanimité ? Pas Benoît Hamon, sans doute. En proposant mardi 4 avril, lors du débat entre les candidats à la présidentielle, la « nationalisation temporaire » des chantiers navals STX de Saint-Nazaire pour éviter une fuite du « savoir-faire » français, le candidat socialiste espérait sans doute se distinguer par une mesure marquée à gauche. En France, le mot « nationalisation » ne réveille-t-il pas immédiatement le souvenir de François Mitterrand et Pierre Mauroy, qui avaient fait hurler la droite en 1981 en prenant le contrôle de Thomson, Saint-Gobain, Pechiney, Paribas, Suez et bien d’autres ?
Rien de tel cette fois-ci. François Fillon s’est au contraire déclaré immédiatement d’accord avec M. Hamon. En 2008, « c’est mon gouvernement qui a fait rentrer l’Etat au capital de STX, justement pour la raison que vous avez évoqué », a rappelé le candidat Les Républicains. Ajoutant : « Effectivement, aujourd’hui, dans la difficulté où se trouve ce chantier et compte tenu des risques de voir le savoir-faire partir, une nationalisation qui ne soit pas permanente, qui soit là pour permettre une solution à cette entreprise, doit être envisagée. »
Bruno Retailleau suit l’affaire de près
Ce n’est pas que M. Fillon soit soudain devenu un chantre de l’intervention publique dans l’économie. Mais son bras droit Bruno Retailleau, qui suit l’affaire de près, l’a convaincu d’accepter une entorse à sa doctrine libérale. Depuis des mois, le président du conseil régional des Pays de la Loire se montre très réservé à l’égard de Fincantieri, le repreneur italien désigné par la justice pour reprendre les chantiers de Saint-Nazaire, lâchés par leur actionnaire majoritaire coréen. Comme les syndicats et la plupart des élus locaux, il craint un transfert des compétences françaises à l’étranger, en particulier en Chine, où Fincantieri a créé une coentreprise. En cas de diminution de l’activité, il redoute aussi que le groupe ne privilégie ses sites italiens au détriment de celui de Saint-Nazaire.
Comme M. Retailleau, M. Fillon milite donc pour que l’industriel de Trieste se contente d’une minorité au capital de STX. Et que s’il refuse, l’Etat, actionnaire à 33 %, utilise son droit de préemption sur les 67 % en jeu. La fameuse « nationalisation temporaire ». L’Etat prendrait donc 100 % du capital, le temps d’organiser un nouveau tour de table, par exemple autour des compagnies de croisière qui font travailler Saint-Nazaire et sont prêtes à en devenir copropriétaires.
La facture politique pourrait être importante
Le consensus autour de ce projet dépasse le duo Hamon-Fillon. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan et même Jacques Cheminade ont tous pris position contre une prise de contrôle italienne. Quant à Emmanuel Macron, il ne peut être hostile au projet alternatif : juste avant de quitter le ministère de l’économie, le 30 août 2016, il peaufinait encore la première offre préparée avec les croisiéristes, qu’il préférait à celle de Fincantieri.
François Hollande et les équipes qui travaillent avec lui à une possible nationalisation temporaire bénéficient donc d’un soutien politique aussi large qu’inattendu.
C’est paradoxalement au sein même des pouvoirs publics qu’apparaissent certaines réserves. Car nationaliser a un coût. Le prix – environ 80 millions d’euros pour les 67 % à vendre – ne paraît pas énorme. Mais la facture politique sur le plan international pourrait être plus importante. Comment justifier le blocage d’un investissement italien en France, quand tant de groupes français font leurs emplettes en Italie ? A quel titre s’opposer à la création du « champion européen » vanté par Rome ? Face aux premières réticences, le gouvernement italien a d’ailleurs, début mars, jugé « un peu extravagant » le fait que l’Italie ne puisse obtenir la majorité de l’actionnariat.
Fin 2012, Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, avait préparé un plan similaire pour nationaliser transitoirement les hauts-fourneaux d’ArcelorMittal à Florange, en Moselle. Mais la volonté de ne pas envoyer de signal trop négatif aux investisseurs étrangers l’avait emporté. Au dernier moment, le projet avait été bloqué par Jean-Marc Ayrault et François Hollande, malgré, là aussi, un certain consensus politique.