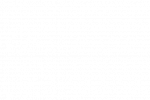La sélection littéraire du « Monde »

La sélection littéraire du « Monde »
Chaque jeudi, « Le Monde des Livres » partage ses conseils de lecture avec les abonnés de « La Matinale ».
LES CHOIX DE LA MATINALE
Cette semaine, deux essais nous replongent au cœur des événements de Mai 68 pour mieux en analyser l’héritage. Côté roman, Milena Agus explore la nostalgie des paradis perdus.
ESSAI. « 1968. De grands soirs en petits matins », de Ludivine Bantigny
Contredire les clichés sur 1968, décaper les faux savoirs et les vrais procès qui font de Mai une simple parenthèse ludique, voire l’origine condamnable des pires travers sociaux, tels sont les buts de Ludivine Bantigny dans cette synthèse nourrie d’une considérable recherche de première main. Seize chapitres ciselés éclairent toutes les facettes de l’événement 1968, depuis l’avant-Mai, d’une surprenante densité revendicative, jusqu’à toutes les formes d’action, d’invention, de contestation et de répression qui surgissent au printemps.
Le livre donne à l’événement son étendue et son imprévu. Sa violence, aussi : les corps endoloris ou rendus infirmes par les coups de matraque au mois de mai et les « morts oubliés de juin » sont évoqués avec une rare force. Ce texte engagé reste pourtant pleinement de l’histoire. De l’histoire, pas seulement au sens disciplinaire et méthodologique mais d’une manière bien plus profonde : un travail sur les acteurs, leurs émotions et leurs mots, sur les temporalités et les possibles, qui donne toute son intelligibilité au passé. André Loez
« 1968. De grands soirs en petits matins », de Ludivine Bantigny, Seuil, « L’univers historique », 450 p., 25 €.
ESSAI. « 68, et après. Les héritages égarés », de Benjamin Stora
L’historien Benjamin Stora revient sur son passé politique, de son entrée, en mai 1968, à l’Organisation communiste internationaliste (OCI), jusqu’à son bref passage par le PS. Pour ce jeune rapatrié d’Algérie, Mai-68 fut l’occasion à la fois de « s’intégrer et [de] contester ». Il relie avec beaucoup de finesse son « romantisme » d’alors et l’intransigeance extrémiste et dogmatique du trotskisme pratiqué à l’OCI, dont il finit par comparer les militants aux jeunes djihadistes d’aujourd’hui, concluant cette évocation par un glaçant : « Heureusement que nous n’avons pas pris le pouvoir. »
Que restait-il à faire, une fois dissipées les illusions de cette radicalité ? Le récit de l’arrivée au PS en 1986 devient vite celui du passage d’une impasse à une autre, ce qui tend à transformer le livre en chant funèbre d’une génération.
Mais les pages finales, sur la transition de l’engagement politique à l’engagement intellectuel, métamorphose du même ancien désir de justice, sonnent comme un réveil, un renouvellement des élans évanouis. Et, si aucune aberration idéologique ni aucune trahison ne s’en trouve justifiée, le passé semble se faire plus léger, et laisser enfin la place aux promesses et aux surprises du présent. Florent Georgesco
« 68, et après. Les héritages égarés », de Benjamin Stora, Stock, « Un ordre d’idées », 184 p., 17,50 €.
ROMAN. « Ne préfère pas le sang à l’eau », de Céline Lapertot
Le troisième roman de Céline Lapertot, 31 ans, se présente comme une fable. Il s’ouvre pourtant sur une situation rien moins qu’inventée, en faisant déferler trois cents réfugiés sur ses premières pages. Ils arrivent à Cartimandua, démocratie occidentale en miniature. On les appelle les « nez-verts ». Ils viennent de contrées désertiques, chercher un peu d’eau dans cette oasis qui en regorge.
Le roman alterne deux types de chapitres : d’un côté, l’histoire de la petite Karole, 10 ans, habituée à « la morsure de la soif » ; de l’autre, ceux mettant en scène Thiego et son ami Titouan, qu’on découvre en prison après qu’à Cartimandua, avec « l’explosion de la Grande Citerne » et la raréfaction de l’eau, les « nez-verts » sont devenus des boucs émissaires. Céline Lapertot excelle à animer le monde des prisonniers comme celui des nez-verts, à faire le portrait du désespoir et de l’inhumanité sans jamais sonner faux. Contre la haine et l’égoïsme, Lapertot appelle au « partage » du monde « par toute l’humanité ». Eric Loret
« Ne préfère pas le sang à l’eau », de Céline Lapertot, Viviane Hamy, 152 p., 17 €.
ROMAN. « La Dissipation », de Nicolas Richard
Entre « le traître », « le cinéaste », « le journaliste qui croit se souvenir d’avoir assisté à l’unique conférence de presse de P », « le traducteur », « l’étudiante » ou encore « celui qui va trop loin », le livre de Nicolas Richard ne manque pas de locuteurs, tous intarissables sur leur objet de recherche ou d’enquête.
Roman ventriloque plutôt que polyphonique, La Dissipation se passe de narrateur pour évoquer, en un concert de voix parfois dissonantes, la figure fuyante de P, un auteur dont le choix de ne rien livrer au public de sa vie privée alimente les fantasmes tout autant qu’il impose le respect. S’il ne fait aucun doute que ce mystérieux P trouve sa source chez Thomas Pynchon, le texte n’a rien d’une synthèse biographique sur le romancier américain contemporain le plus secret, le plus commenté et le plus culte.
Ceux qui le souhaitent peuvent bien prendre le roman comme le point de départ d’un jeu incitant à enquêter par soi-même pour démêler le vrai du faux, comme y invitent les romans de Pynchon eux-mêmes. Mais La Dissipation est avant tout une machinerie bien huilée, qui réussit à produire de la fiction et de la littérature en dépassant les contraintes qu’elle s’est imposées. A l’image des plus beaux textes oulipiens de Georges Perec, et en premier lieu le lipogramme en « e » de La Disparition (Gallimard, 1969), auquel Nicolas Richard rend un hommage aussi évident qu’élégant. Florence Bouchy
« La Dissipation », de Nicolas Richard, Inculte, 188 p., 17,90 €.
ROMAN. « Terres promises », de Milena Agus
Terres promises. Si Milena Agus – l’auteure de Mal de pierres (Liana Levi, 2007) – insiste sur ce pluriel, c’est que chacun ici a la sienne. Exaltante parfois, accablante hélas le plus souvent, comme les asphyxiantes chimères de Baudelaire.
Celle de Raffaele est sentimentale. Ce fils de paysan sarde vit dans la nostalgie de son paradis perdu, Gênes, la ville où il a découvert la mer et la Marine. Pour son épouse Ester, c’est le contraire : elle a tant idéalisé la Sardaigne, son île natale, qu’elle n’a plus que ça en tête : y retourner. Tandis que pour Felicita, leur fille, le salut ne peut venir que du communisme…
Ce que décrit fort bien Milena Agus, ce n’est pas seulement le côté illusoire de ces constructions mentales. C’est aussi leur potentiel destructeur. Incompatibles entre elles, les terres promises de chacun minent la vie de famille, en particulier, où l’addition des rêves individuels finit par ne plus produire que de la frustration pour tous. Il n’empêche : chacun s’y agrippe, comme si son identité profonde en dépendait.
Entre les lignes, Agus s’amuse. Elle montre comment chaque personnage se bricole un petit idéal portatif – souvent le pur fruit du hasard ou des circonstances – et se met à y croire dur comme fer. La morale de l’histoire ? Il n’y en a pas, c’est un roman. Mais en exergue, Milena Agus a mis cet extrait d’Amos Oz : l’histoire de croisés partis délivrer Jérusalem et qui, après avoir souffert mille morts, décident d’achever leur épuisant périple. Ils s’arrêtent dans un endroit agréable et le nomment Jérusalem. Et si la terre, ferme, là, maintenant, tout de suite, valait mieux que la promise ? Florence Noiville
« Terres promises », de Milena Agus, traduit de l’italien par Marianne Faurobert, Liana Levi, 176 p., 15 €.