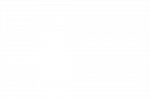Le « temps libre » dans cette société du divertissement fait-il notre bonheur ?

Le « temps libre » dans cette société du divertissement fait-il notre bonheur ?
Le temps de loisirs est devenu temps de consommation et de « diversion » du travail taylorisé, analyse le professeur de philosophie Thomas Schauder, qui défend un droit de créer, rêver…
Au fur et à mesure le temps de loisir est devenu un marché, il a été récupéré par la logique du travail alors même qu’il était traditionnellement ce qui lui échappait essentiellement. / HERVÉ DE GUELTZL / Photononstop
Chronique Phil’d’actu. L’événement de la semaine du 9 au 15 avril n’était ni l’intervention aérienne française en Syrie, ni le conflit entre « zadistes » et gendarmes mobiles à Notre-Dame-des-Landes, ni la mobilisation des étudiants contre la réforme de l’université. Non. Le grand événement, c’était l’annonce du sexe du bébé de Manon et Julien dans l’émission « Les Marseillais Australia » sur W9.
Si vous ne le saviez pas, c’est que vous ne faites pas partie des 700 000 à 800 000 téléspectateurs (sans compter les internautes) qui ont suivi cette télé-réalité depuis 2012. C’est beaucoup, mais moins que « Touche pas à mon poste ! », sur C8, qui dépasse régulièrement le million et demi de téléspectateurs.
Loin d’être anecdotiques, ces chiffres sont révélateurs du rapport d’une part importante de la société au divertissement. La semaine dernière, je vous ai parlé du taylorisme et des injonctions à normaliser les gestes et à optimiser le temps de travail. Examinons aujourd’hui un autre aspect de cette question : pourquoi, alors que nous sommes incités à ne pas « perdre notre temps », la télévision propose-t-elle autant de programmes destinés à « passer le temps » ?
Ne pas confondre le loisir et le divertissement
Des penseurs grecs de l’Antiquité aux marxistes de la fin du XIXe siècle, le temps de loisir a été considéré comme le temps soustrait aux activités « biologiques » du travail et du repos. Ce faisant, il était le temps que l’homme pouvait consacrer au développement de ses aptitudes proprement humaines : la vie politique, la culture (ce n’est pas pour rien qu’en grec, « loisir » se dit scholè, qui a donné le mot « école »), l’art, le sport, etc.
Le taylorisme industriel et l’automatisation ont permis de libérer progressivement du temps de loisir parce qu’il était possible de produire autant, voire plus, en moins de temps. Les travailleurs ont ainsi pu gagner les congés payés, l’interdiction du travail des enfants, le droit à la retraite, etc. Mais elle est bien lointaine l’époque où le patronat fustigeait cette « incitation à la paresse » : le marché a rapidement vu l’intérêt économique de ce temps que le travailleur pouvait consacrer à consommer d’autres choses que ce qui était nécessaire à sa survie.
Au fur et à mesure, donc, le temps de loisir est devenu un marché, il a été récupéré par la logique du travail, alors même qu’il était, traditionnellement, ce qui lui échappait essentiellement. Comme le notaient Theodor Adorno et Max Horkheimer en 1947, à propos de « l’industrie culturelle » :
« Dans le capitalisme avancé, l’amusement est le prolongement du travail. Il est recherché par celui qui veut échapper au processus du travail automatisé pour être de nouveau en mesure de l’affronter. »
Le temps de loisir a ainsi subi une double transformation : d’un côté, il est un temps de consommation ; de l’autre, un temps de « divertissement » au sens de « ce qui fait diversion », ce qui permet de regarder ailleurs, d’oublier les tracas de la vie réelle en étant absorbé dans le spectacle :
« Le spectacle soumet les hommes vivants dans la mesure où l’économie les a totalement soumis. Il n’est rien que l’économie se développant par elle-même. (…) Pour amener les travailleurs au statut de producteurs et consommateurs “libres” du temps-marchandise, la condition préalable a été l’expropriation violente de leur temps. » (Guy Debord, La Société du spectacle, 1967.)
« Se vider la tête »
Au contraire du loisir, le divertissement n’est pas du temps soustrait aux nécessités biologiques : il en fait partie intégralement. Dans une organisation du travail où les biens sont difficiles à obtenir et nécessitent un effort intense, la priorité pour pouvoir reconstituer sa force de travail est le repos (manger, boire et dormir). Mais dans la société taylorisée où la difficulté est moins physique que psychologique (dans la mesure où l’on pourrait séparer ces deux dimensions, alors que le phénomène du burn-out est l’exacte preuve du contraire), le divertissement est aussi nécessaire que le pain. Il s’agit pour le travailleur de « se vider la tête », expression révélatrice du besoin de consacrer ce temps libéré du travail à oublier ce dernier.
Concrètement, le divertissement n’est pas un temps d’inactivité, comme le prouvent les phénomènes de dépendance aux écrans, y compris chez les jeunes enfants. Dès qu’on a un instant de libre, on va le consacrer à regarder ce qui se passe sur Facebook ou à jouer à l’un de ces petits jeux assez débilitants sur son smartphone. Ce ne sont là que les avatars contemporains du besoin de « faire diversion » et leur dépendance est assez proche de l’alcoolisme du travailleur de la fin du siècle dernier, celui que décrit Joe à Martin Eden dans le roman éponyme de Jack London (1909) : « J’avais jamais envie de boire, à l’hôpital. C’est drôle, hein ? Mais, quand j’ai marné comme un esclave pendant toute une semaine, faut que je me cuite. »
Le divertissement fait ainsi partie intégrante de l’injonction à la rentabilité du temps à l’œuvre dans la « taylorisation de l’existence » : il consiste bel et bien en une activité qui non seulement sert le processus biologique, mais aussi le processus de production économique, puisqu’il fait vivre les industries culturelles et technologiques. Il est une activité de consommation pulsionnelle, et à ce titre est soumis aux mêmes exigences que le monde du travail dont il est le pendant :
« La société de masse (…) ne veut pas la culture, mais le divertissement (entertainment) (…) et les articles offerts par l’industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. (…) Ils servent, comme on dit, à passer le temps, et le temps vide qui est ainsi passé n’est pas, à proprement parler, le temps de l’oisiveté (…). Et la vie biologique est toujours, au travail ou au repos, engagée dans la consommation ou dans la réceptivité passive de la distraction, un métabolisme qui se nourrit des choses en les dévorant. (…) Les critères d’après lesquels on les devrait (…) juger sont la fraîcheur et la nouveauté. » (Hannah Arendt, La Crise de la culture, 1961.)
Droit à l’inutilité et au temps perdu
Finalement, les formes contemporaines du divertissement et leur place dans la vie quotidienne ne sont que les symptômes actuels d’un drame humain, celui que décrivait Blaise Pascal au XVIIe siècle : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Nous sommes nombreux à craindre l’inactivité, synonyme de l’ennui. Nous ne voulons pas penser au « malheur naturel de notre condition faible et mortelle ». Pour Blaise Pascal, le divertissement est une solution à ce problème : « Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser. »
Le divertissement nous offre une solution pour être heureux, mais il nous fait manquer ce qui pourrait nous rendre véritablement heureux puisqu’il ne nous offre qu’une vision standardisée et impersonnelle du bonheur. Au lieu de « ne rien faire », nous ne « faisons rien » : nous occupons notre temps au lieu de prendre le temps de nous poser des questions, de penser, de contempler, de nous laisser aller à l’émerveillement. Nous nous « vidons la tête » au lieu de la remplir de tout ce qui pourrait donner un sens à nos actions.
Or le temps de l’inactivité est celui qui rend possible l’activité, d’inventer, de créer, de rêver, bref de nous soustraire réellement aux injonctions du marché et du travail. Aujourd’hui, la productivité et la richesse n’ont jamais été aussi importantes. L’occasion nous est offerte de réclamer un « droit à la paresse » (selon l’expression de Paul Lafargue), un droit à l’inutilité et au temps perdu. Et si ce droit devenait l’enjeu des luttes sociales de demain ? On a bien le droit de rêver…
Un peu de lecture ?
– Guy Debord, La Société du spectacle (Folio Gallimard, 2002).
– Hannah Arendt, La Crise de la culture (Folio Gallimard, 2003).
– Theodor Adorno et Max Horkheimer, Kulturindustrie (Allia, 2012).
A propos de l’auteur de la chronique
Thomas Schauder est professeur de philosophie. Il a enseigné en classe de terminale en Alsace et en Haute-Normandie. Il travaille actuellement à l’Institut universitaire européen Rachi, à Troyes (Aube). Il est aussi chroniqueur pour le blog Pythagore et Aristoxène sont sur un bateau. Il a regroupé, sur une page de son site, l’intégralité de ses chroniques Phil d’actu, publiées chaque mercredi sur Le Monde.fr/campus.