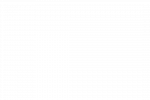Expositions Basquiat-Schiele : pourquoi réunir ces deux géants de l’art ?
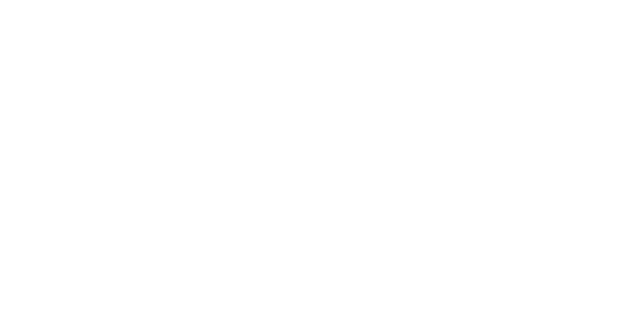
Expositions Basquiat-Schiele : pourquoi réunir ces deux géants de l’art ?
Par Philippe Dagen
La Fondation Louis Vuitton rapproche Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele. Pour quelle raison rassembler ces deux artistes, qu’un demi-siècle et l’Atlantique séparent ? C’est que tous deux, en offrant une vision crue du monde, se ressemblent plus qu’il n’y paraît.
C’est presque devenu une habitude : exposer les artistes non plus seuls, en rétrospective monographique façon Grand Palais, mais par paire. Ainsi, dans le passé, a-t-on vu ensemble, à Amsterdam ou Paris, Caravage et Rembrandt, Van Gogh et Munch, Matisse et Picasso. Cet été, à Aix-en-Provence, c’était Picasso et Picabia, et cet automne, à Londres, Mantegna et Bellini. Il y a eu, plus rares, quelques triades, dont celle réunissant Turner, Whistler, Monet.
Pourquoi procéder ainsi ? Une explication cynique vient à l’esprit au seul énoncé des noms des artistes : ils jouissent tous d’une immense notoriété. Il est donc tentant de supposer que les réunir, c’est multiplier par deux la probabilité du succès et le nombre de visiteurs. Cela est en effet très probable, à une sérieuse réserve près : parce que ces peintres sont universellement connus, il est difficile d’emprunter leurs œuvres aux collections privées et publiques qui les conservent.
« Autoportrait » (1984), par Jean-Michel Basquiat, acrylique et crayon gras sur papier marouflé sur toile. / Collection Ernst Ploil, Vienne
Plusieurs raisons à cela. Premièrement, tout musée rechigne à se séparer pendant plusieurs mois d’œuvres qui lui assurent une partie de sa fréquentation, laquelle s’en trouve affectée. Deuxièmement, tout collectionneur hésite à laisser partir ses chefs-d’œuvre, fragiles de surcroît, si bien conditionnés et assurés soient-ils. Ce principe de précaution retient les Demoiselles d’Avignon captives au MoMA et la Joconde enfermée au Louvre.
Troisièmement, pour lever ces réticences, ceux qui veulent emprunter un autoportrait de Rembrandt, de Van Gogh ou de Frida Kahlo doivent en avoir les moyens : pouvoir payer des transports archisécurisés, des assurances calculées selon la valeur marchande supposée de l’œuvre et, de plus en plus souvent, ce que l’on nomme dans le vocabulaire de la profession des « fees », ce qui signifie littéralement des frais, en réalité le montant de la location de l’œuvre. Aussi, l’art des expositions à deux n’est-il pas si simple à pratiquer et ne peut-il l’être que par des institutions à la puissance financière garantie.
Encore faut-il qu’il y ait quelque raison au mariage, la conjonction de deux gloires étant loin de suffire à le justifier. Souvent, il s’explique par l’histoire : Mantegna et Bellini étaient d’exacts contemporains – ils étaient même beaux-frères –, Matisse et Picasso amis et rivaux leur vie entière. Tel n’était pas le cas de Caravage et Rembrandt. Tel n’est pas celui de Schiele et Basquiat, que séparent plus d’un demi-siècle et l’Atlantique. Sans doute Basquiat, dont la connaissance de l’histoire de l’art était grande, a-t-il connu Schiele, mais sa propre œuvre n’en porte que bien peu de traces.
Jean-Michel Basquiat, sans titre, 1982. / PRIVATE COLLECTION / ESTATE OF JEAN-MICHEL BASQUIAT / LICENSED BY ARTESTAR, NEW YORK
Dans ce cas, pourquoi les réunir ? Parce qu’ils sont morts jeunes tous deux ? Faible prétexte. L’un a succombé à la grippe espagnole, l’autre à une overdose : morts accidentelles dont il n’y a pas plus à conclure que de celles, tout aussi précoces et imprévues, de Raphaël ou de Géricault. Une raison bien plus convaincante est que tous deux font voir crûment à leurs contemporains ce que ceux-ci préfèrent faire semblant d’ignorer.
Hypocrisies de la société austro-hongroise
Schiele doit exprimer combien il se sent prisonnier de la société de l’empire austro-hongrois au début du XX° siècle, de ses interdits, de ses hypocrisies : la contrainte exercée sur les corps féminins et masculins et les désirs qui les animent. Désirs troubles, pulsions dangereuses parfois ? C’est certain, mais, pour dessiner la vérité de l’intime, il faut que Schiele la dessine tout entière, au risque de la censure et de la prison. Il est, on ne peut l’oublier, le contemporain de Freud et de la naissance de la psychanalyse.
Pour que cette vérité soit clairement visible sur le papier, il lui faut des dévoilements exhibitionnistes, des postures indécentes, un trait continu qui entre dans les détails et les plis, des rehauts de couleurs acides sur le blanc du papier. Il faut donc qu’il rompe avec les usages académiques, nus épilés, nymphes chastes et portraits de grandes dames en robe du soir. Schiele brise les règles plastiques que l’on enseigne dans les académies des beaux-arts comme il brise les règles morales que l’on enseigne dans les catéchismes.
Un quotidien pauvre et cruel
Basquiat doit exprimer quel malaise il ressent dans la société nord-américaine des années 1980, au temps de Ronald Reagan, ce président qui commence par ne pas prendre au sérieux le sida et ne fait rien pour combattre le racisme, si l’on peut dire ordinaire, des Etats-Unis. S’il y a dans son œuvre tant d’allusions à la traite, à l’esclavage, à la ségrégation sociale et économique, il n’est pas difficile de savoir pourquoi : il suffit de se reporter à l’histoire de cette période. S’il projette sur la toile les mots et les signes qu’il a d’abord inscrits sur les murs, c’est une façon pour lui de faire surgir le quotidien pauvre et cruel de la ville dans la paix riche des galeries et des musées.
Il lui faut donc rompre avec la sérénité abstraite et propre du minimalisme et de ses géométries. Le dessin doit être figuratif et dur, les symboles brutalement explicites, la couleur violemment contrastée, les surfaces salies, les formes heurtées et creusées. Basquiat brise les règles plastiques qui dominent depuis les années 1970 l’art contemporain new-yorkais comme il brise le silence en imposant le point de vue d’un Afro-Américain. Ainsi considérés, les deux artistes se ressemblent.
Ces article fait partie d’un dossier réalisé dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Louis Vuitton.
Fondation Louis Vuitton : Jean-Michel Basquiat ou la rage de vaincre
Fondation Louis Vuitton : Egon Schiele ou la rage de vivre