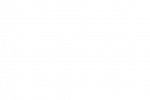Nos films coups de cœur de 2018

Nos films coups de cœur de 2018
Les critiques cinéma du « Monde » ont chacun(e) désigné les cinq œuvres qui les ont le plus ému(e)s et convaincu(e)s cette année.
La sélection de Véronique Cauhapé
- Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-eda
- Roma, d’Alfonso Cuaron
- Amanda, de Mikhaël Hers
- Un amour impossible, de Catherine Corsini
- Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré
Socle des liens fondateurs d’une vie et théâtre de toutes les névroses, la famille a été soumise cette année à des examens qui en ont révélé la grandeur, les battements irréguliers et les maux plus ou moins bénins. Composée en marge de la loi, au fil du hasard et au gré des petits arrangements dans Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-eda ; exposée à un amant et un père incestueux qui l’empêche autant qu’elle la détruit dans Un amour impossible, de Catherine Corsini : interrompue dans son élan par un attentat, dans Amanda, de Mikhaël Hers, la famille a ouvert des albums singuliers et puissants. Celui d’Alfonso Cuaron réunissant – et revisitant par la grâce d’un cinéaste devenu adulte – ses propres souvenirs d’enfance, durant l’année 1971, dans le quartier résidentiel de La Colonia Roma à Mexico. Enfin, il serait injuste d’extraire de cette sélection Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré, sous prétexte que le thème familial en est exclu ; l’amour, dans l’ombre de la menace mortelle du sida dans les années 1990, n’ayant d’autre avenir que sa disparition.
La sélection de Clarisse Fabre
Séverine Jonckeere et Luc Chessel dans « Milla », de Valérie Massadian. / JHR FILMS
- Milla, de Valérie Massadian
- Les Garçons sauvages, de Bertrand Mandico
- Cassandro the Exotico !, de Marie Losier
- Have a Nice Day (H.A.N.D.), de Liu Jian
- Woman at War, de Benedikt Erlingsson
Plus que jamais, il fallait de la poésie, du burlesque, du surréalisme et quelques rêves éveillés pour sublimer l’absurdité du monde et le destin de héros très contemporains. Chacun(e) dans sa « traversée » géographique, sociale ou mentale. Les voici, sans ordre de préférence : une jeune femme privée de tout (Milla) se reconstruit dans un cadre épuré et délicat comme une larme de Man Ray. D’étranges bad boys ou créatures sauvages mutent et se réenchantent dans un paradis visuel à la Jean Cocteau. Un jeune voleur se rêve en prince charmant le temps d’une nuit bleu pétrole, dans les faubourgs pauvres de la Chine magnifiquement peints et animés (H.A.N.D.). Ailleurs, une super-héroïne, digne de Peau d’Ane, vaincra non pas le père, mais l’usine polluante, par la grâce d’un scénario fantastique. Capté dans la beauté satinée du 16 millimètres, Cassandro, catcheur gay, félin, fellinien, finit par se révéler masculin et féminin. En 2018, le cinéma aura chassé les garçons, les filles et tout le reste. Pour ne retenir que les humains.
La sélection de Murielle Joudet
Shaïn Boumedine et Hafsia Herzi, dans « Mektoub My Love : Canto Uno », d’Abdellatif Kechiche. / QUAT’SOUS FILMS / PATHÉ FILMS / FRANCE 2 CINÉMA / GOOD FILMS / BIANCA / NUVOLA FILM
- Mektoub, My Love : Canto Uno, d’Abdellatif Kechiche
- The House That Jack Built, de Lars Von Trier
- Pentagon Papers, de Steven Spielberg
- Thunder Road, de Jim Cummings
- First Man, de Damien Chazelle
Au premier abord, Mektoub, My Love et The House That Jack Built n’ont rien à se dire. Tout sépare Amin, le héros de Kechiche, et Jack, le psychopathe de Lars von Trier : l’un observe timidement le corps des filles et rêve de les prendre en photo, l’autre les tue sauvagement et les entasse dans une chambre froide. D’un côté, un soleil d’été qui irradie tout, la lumière d’un grand désir. De l’autre, un froid de lune, les ténèbres d’une conscience. Les films sont en fait jumeaux : les deux cinéastes s’inventent des alter ego, réalisent des films-monstres de plus de deux heures, proposent une version outrée et fantasmatique de leur monde intérieur. Ce sont leurs plus beaux films : un paradis charnel d’un côté, une catharsis farcesque de l’autre. Quant à Spielberg, Pentagon Papers figure la quintessence de son art, un geste parfait et assuré qui enroule l’éclat d’une conscience féminine dans celui d’une conscience collective. Thunder Road et First Man travaillent un même thème, celui du deuil. Cummings : une crise tragi-comique qui délire le monde et sauve seulement une petite fille. Chazelle : la surface lunaire comme espace mental, texture même du deuil.
La sélection de Jacques Mandelbaum
Salim Kechiouche et Ophélie Bau dans « Mektoub My Love : Canto Uno », d’Abdellatif Kechiche. / QUAT’SOUS FILMS / PATHÉ FILMS / FRANCE 2 CINÉMA / GOOD FILMS / BIANCA / NUVOLA FILM
- Mektoub, My Love : Canto Uno, d’Abdellatif Kechiche
- La Douleur, d’Emmanuel Finkiel
- High Life, de Claire Denis
- Madame Hyde, de Serge Bozon
- Burning, de Lee Chang-dong
Ces très beaux films nous regardent depuis un entre-deux mondes. Autant dire qu’ils sont de notre temps, de notre inquiétude, de notre aspiration à une vitalité, un climat, une promesse, qui semblent nous fuir. Ils nous invitent à considérer les choses du point de vue d’un héros suspendu sur le seuil. Seuil d’un monde hédoniste que le jeune apprenti cinéaste de Mektoub, My Love semble appelé à célébrer plus qu’à vivre. Seuil d’un retour fiévreusement attendu à la vie pour l’héroïne durassienne de La Douleur, depuis un Paris de l’Occupation extraordinairement ressenti. Seuil d’une problématique continuation de l’espèce pour le cosmonaute et sa fille dérivant dans l’espace de High Life. Seuil de la transmission du savoir en banlieue, passé lequel une enseignante de banlieue se métamorphose en femme-torche dans Madame Hyde. Seuil enfin depuis lequel un aspirant écrivain, fils de paysan, est appelé à se positionner dans un triangle amoureux qui le ravale cruellement à sa condition. L’idée du seuil marque ici une écologie universelle de la création : un art urgent du retrait auquel il faut consentir pour espérer avancer.
La sélection de Mathieu Macheret
Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara, Rira Kawamura et Sachie Tanaka dans « Senses », de Ryusuke Hamaguchi. / ART HOUSE
- Senses, de Ryusuke Hamaguchi
- Mektoub, My Love : Canto Uno, d’Abdellatif Kechiche
- Zama, de Lucrecia Martel
- Burning, de Lee Chang-dong
- Seule sur la plage la nuit, de Hong Sang-soo
Que se passe-t-il dans la tête des personnages ? Beaucoup des plus beaux films de 2018 ont fait le pari de filmer les êtres de l’intérieur, au plus profond d’eux-mêmes. La plongée la plus saisissante fut sans doute celle de Senses, du Japonais Ryusuke Hamaguchi, examinant dans le détail la vie de quatre amies quarantenaires amenées à se défaire des aliénations du quotidien. Avec Zama, la cinéaste argentine Lucrecia Martel sonde le délitement psychique de l’administration coloniale, dans l’Amérique latine du XVIIIe siècle. Burning, du Sud-Coréen Lee Chang-dong, infiltre un étrange trio amoureux, où les fermentations du désir émanent des névroses de classe. Son compatriote Hong Sang-soo continue de mélanger les versions rêvées et vécues de la réalité, pour traduire le désarroi amoureux de son héroïne, errant Seule sur la plage la nuit. Enfin, Mektoub, My Love, d’Abdellatif Kechiche, s’engouffre dans un étourdissant tunnel de sensations solaires et d’exaltation charnelle, en secondant le regard avide d’un apprenti cinéaste. Extension du corps ou miroir de la conscience, le cinéma ne fut jamais aussi convaincant qu’ainsi infiltré au cœur des subjectivités.
La sélection de Jean-François Rauger
Alek Skarlatos et Anthony Sadler dans « Le 15 h 17 pour Paris », de Clint Eastwood. / KEITH BERNSTEIN / WARNER BROS. ALL RIGHTS RESERVED
- Le 15 h 17 pour Paris, de Clint Eastwood
- Mektoub, My Love : Canto Uno, d’Abdellatif Kechiche
- The House That Jack Built, de Lars Von Trier
- Que le diable nous emporte, de Jean-Claude Brisseau
- Burning, de Lee Chang-dong
Le plus beau film de l’année est une réflexion sur la dimension paradoxale de l’héroïsme, sur le besoin humain de raconter des histoires, sur l’idée même d’action, sur la contingence et la fatalité, indissociablement mêlées. Les personnages du 15 h 17 pour Paris sont présents au monde parce que totalement inconscients, efficaces parce qu’aveugles. Ce sont des perdants ordinaires qui emportent tout à la fin, sans doute par hasard. Et Clint Eastwood n’en finit pas d’interroger une certaine conception du geste et de la morale. Jean-Claude Brisseau continue d’explorer des zones inexplorées par le cinéma, celle d’un érotisme métaphysique inédit. Le Coréen Lee Chang-dong réussit son meilleur film en croisant le ressentiment de classe avec une dimension fantastique. Dans son film-essai, Lars von Trier déconstruit les conventions du cinéma pour affirmer, avec un humour méchant, la présence inéluctable du mal et de la destruction dans l’art. Enfin, le film solaire d’Abdellatif Kechiche restitue cette sensation que parfois (rarement) le cinéma propose : que se passe-t-il lorsqu’il ne se passe rien ? Mention spéciale pour The Other Side of the Wind, d’Orson Welles, enfin achevé grâce à Netflix.
La sélection de Thomas Sotinel
Yoo Ah-in, Jeon Jong-seo et Steven Yeun dans « Burning », de Lee Chang-dong. / DIAPHANA DISTRIBUTION
- Burning, de Lee Chang-dong
- Roma, d’Alfonso Cuaron
- Zama, de Lucrecia Martel
- Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-eda
- High Life, de Claire Denis
Le public français s’est vu interdire le spectacle sur grand écran du plus élaboré de ces cinq films, Roma, diffusé sur Netflix. Mais les Japonais se sont précipités en masse pour voir Une affaire de famille. On ne parle anglais que dans un seul de ces longs-métrages, il a été tourné en Allemagne par Claire Denis, une Française, comme si Hollywood, trop occupé à ses restructurations, laissait la créativité en jachère. Deux films américains auraient néanmoins pu trouver leur place dans ce classement, Pentagon Papers, de Steven Spielberg, et Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson. Et la quasi-parité qu’on y constate n’est pas le résultat d’un effort conscient, plutôt d’une évidence. On aurait donc envie de dire que tout bouge, si ces cinq films n’étaient le fait de cinéastes en pleine maturité. Manque la révélation (ou même la confirmation) d’un talent nouveau, car la réussite spectaculaire de Black Panther témoigne autant de la domestication de Ryan Coogler par l’industrie lourde que de l’épanouissement de son talent.