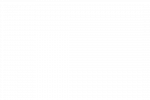En Ethiopie, Emmanuel Macron au chevet de la « Jérusalem d’Afrique »

En Ethiopie, Emmanuel Macron au chevet de la « Jérusalem d’Afrique »
Par Emeline Wuilbercq (Lalibela (Ethiopie), envoyée spéciale)
Le chef de l’Etat se rend à Lalibela, un site de onze églises orthodoxes rupestres du XIIIe siècle que la France doit contribuer à préserver et restaurer.
L’église Merqorewos, à Lalibela, en Ethiopie, le 7 mars 2019. / EDUARDO SOTERAS / AFP
De sa croix en bois, Sahalu Dejene pointe le plafond d’Amanuel, l’une des onze églises de Lalibela. « Fissuré d’un bout à l’autre », se désole le prêtre. Dans cette ville située dans le nord de l’Ethiopie, à 2 600 mètres d’altitude, la population s’accorde pour dire qu’Amanuel est la plus dégradée des églises creusées dans la roche au XIIIe siècle. Mais cela ne signifie pas que les autres sont en bon état…
Victimes des ans, des fortes pluies qui s’abattent entre juin et septembre et du soleil qui brûle le reste de l’année, ces trésors classés au patrimoine mondial de l’Unesco depuis quarante ans sont en danger. « Je suis ici jour et nuit. J’y venais déjà petit garçon. C’est de pire en pire », déplore Sahalu Dejene, emmitouflé dans son gabi, la traditionnelle couverture de coton. Pour les 45 millions d’Ethiopiens orthodoxes, Lalibela est la « Jérusalem d’Afrique ». Un lieu sacré qui attire chaque année des dizaines de milliers de touristes et de pèlerins.
Mardi 12 mars, le président français, Emmanuel Macron, doit lui aussi visiter ce haut-lieu du christianisme orthodoxe éthiopien, dans le cadre d’une tournée dans la Corne de l’Afrique commencée lundi soir à Djibouti et qui se poursuivra mercredi au Kenya. En octobre 2018, lors de son voyage à Paris, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, lui avait demandé de l’aide pour la restauration des églises. La France, qui, depuis, a envoyé des experts sur le site à plusieurs reprises, devrait « s’engager à financer la mise en sécurité des églises et leur restauration », confie une source proche du dossier.
Des abris peu esthétiques
Le nouveau maire de Lalibela, Mulugeta Michael, se réjouit de cette prise de conscience : « Avant, notre gouvernement n’affichait aucun volontarisme en faveur de nos églises. Mais aujourd’hui, Lalibela fait l’objet d’une réelle attention et cela suscite un grand espoir dans la population. » En octobre, ils avaient été des milliers à manifester pour que cet héritage unique au monde soit préservé, leur première demande étant « qu’on enlève les toits de protection » qui recouvrent cinq églises, explique Tegegne Yirdaw, un peintre local.
Une Ethiopienne orthodoxe s’abrite du soleil entre deux églises de Lalibela couvertes par des toits de protection, le 6 mars 2019. / EDUARDO SOTERAS / AFP
Ces abris peu esthétiques installés il y a onze ans pour protéger les églises rupestres ne font pas consensus. Financés par l’Union européenne à hauteur de 7,4 millions d’euros, ils devaient être temporaires mais sont toujours là. Aujourd’hui, les gens craignent « qu’ils tombent et détruisent les églises », poursuit l’artiste, évoquant les vents violents qui soufflent sur ces hauts plateaux et dont la vitesse n’aurait pas été convenablement mesurée avant l’installation des bâches soutenues par des piliers métalliques fixés au sol dans la cour des édifices. « Parfois, les habitants prient toute la nuit pour les protéger », raconte Kidanemariam Woldegiorgis, un archéologue originaire de Lalibela.
Les avis sont partagés. Un rapport de l’université d’Addis-Abeba pointe des problèmes structurels des protections que les experts français n’auraient pas repérés lors de leur récent passage, hormis sur l’un des abris. Alors que les études techniques et les plans qui ont permis de les édifier restent introuvables, la France va « probablement les enlever tels qu’ils existent aujourd’hui. Comment ? Nous ne savons pas », confie une source française. L’historienne Marie-Laure Derat, qui co-dirige une mission franco-éthiopienne de fouilles archéologiques près des églises, met pourtant en garde contre une nouvelle exposition des édifices aux intempéries, qu’elle estime très dangereuse. Pour elle, « les églises ont besoin d’être couvertes » et, plutôt que retirer les abris, l’alternative pourrait être d’alléger les piliers.
« Nous craignons la corruption »
La population locale reste échaudée par les campagnes de restauration entreprises au milieu du XXe siècle. A l’époque, « nous manquions d’argent et de compétences, nous avions confiance dans le savoir-faire des étrangers », se souvient Mekonnen Gebremeskel, l’un des directeurs administratifs de l’Eglise orthodoxe à Lalibela ; mais leurs interventions ont « torturé » les églises. « Deux d’entre elles ont été badigeonnées d’une peinture rouge à base de goudron qu’il a fallu retirer ensuite à coups de pioche ! Sans parler de l’utilisation intensive de ciment », explique Blen Taye Gemeda, doctorante en sciences du patrimoine à l’université d’Oxford.
Des Ethiopiens orthodoxes sortent de l’église Amanuel, à Lalibela, près d’un des piliers soutenant le toit qui protège l’édifice des intempéries, le 7 mars 2019. / EDUARDO SOTERAS / AFP
Aujourd’hui plane une suspicion envers ces experts venus d’ailleurs dont les récents travaux ne sont pas forcément appréciés. Le père Belay Habtamu, qui est chargé de l’église Golgotha Mikael, restaurée l’an dernier grâce au Fonds mondial pour les monuments et l’ambassade des Etats-Unis, se plaint de l’enduit utilisé pour combler les fissures. De couleur différente, il a laissé des traces sur la roche. « Ça se détache déjà alors que ça fait moins d’un an », ajoute le prêtre, qui n’est pas non plus satisfait des gouttières installées sur les toits pour laisser l’eau de pluie s’écouler. « Ça tombe directement ici », explique-t-il en montrant un muret qui a déjà été restauré deux fois et qui risque de se détériorer encore pendant les fortes pluies. « J’ai peur. Je pleure quand je vois ça. Nous espérons que la France fera un meilleur travail », poursuit-il, regrettant que sa communauté n’ait jamais été consultée.
Les travaux de retrait des abris et de conservation des toits des églises de Lalibela devraient coûter plus de 9 millions d’euros, selon l’Autorité éthiopienne pour la conservation du patrimoine. La France a déjà débloqué des fonds pour financer le début des études. Mais les Ethiopiens veulent suivre tout cela de près… « En raison d’affaires passées, nous craignons la corruption », s’inquiète Yirga Gelaw Woldeyes, chercheur en philosophie à l’université Curtin, en Australie. En 2010, un projet de reconstruction paysagère financé la Banque mondiale, qui a entraîné le déplacement contraint de milliers d’habitants, n’a pas satisfait les attentes. « Où est passé l’argent de la Banque mondiale ? », demandaient les manifestants en octobre. Alors M. Yirga met en garde : « L’équipe française doit adopter un mécanisme de transparence permettant de savoir comment est dépensé l’argent de l’aide. »