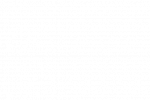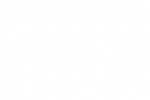L’économie collaborative « porte en elle des inégalités abyssales »

L’économie collaborative « porte en elle des inégalités abyssales »
Propos recueillis par Jessica Gourdon
Monique Dagnaud, sociologue, a étudié ce pan de l’économie numérique et les inégalités que ces nouveaux modèles contribuent à créer. Elle sera l’invitée du « Monde » lors d’une conférence sur la ville des millennials, vendredi 2 février.
L’économie collaborative, mouvement qui croise innovations technologiques et sociales, dessine une nouvelle vision de la ville. Mais cette économie, avant tout portée par de jeunes générations urbaines et diplômées, creuse aussi le fossé entre ceux qui peuvent y participer et les autres. C’est ce que constate Monique Dagnaud, directrice de recherches au CNRS, dans son livre Le Modèle californien. Comment l’esprit collaboratif change le monde (Odile Jacob). La sociologue y étudie ce morceau de l’économie numérique qui a donné naissance à Airbnb, BlablaCar, Uber et à toutes ces plates-formes qui permettent, par exemple, de faire garder ses animaux chez un particulier, de trouver quelqu’un pour accompagner un enfant en train, d’échanger son appartement ou de louer sa voiture à un inconnu.
Quelles sont les racines de l’économie collaborative ?
C’est une économie, qui a pris son essor grâce à Internet et aux innovations technologiques, et qui repose sur certaines valeurs qui sont particulièrement celles de la jeunesse diplômée. Son système de production peut être non marchand, ou très bien ancré dans l’économie capitaliste : cela va de Slideshare, du couchsurfing et des AMAP jusqu’à Airbnb ou Uber. Il y a donc beaucoup de gradations. Cette économie a, en tout cas, donné naissance à une multitude de nouveaux services, qui s’inscrivent dans ce que Jérémy Rifkin appelle « l’âge de l’accès ». L’usage compte plus que la propriété. Le plaisir, l’expérience comptent plus que la possession. C’est aussi une économie qui s’enracine dans une dimension écologique, dans le sens où elle se base souvent sur l’utilisation de ressources existantes : des sièges libres de votre voiture, une chambre de votre appartement, une place de parking vide…
Vous expliquez que ce modèle s’est construit en opposition aux institutions traditionnelles. Y a-t-il une philosophie politique derrière ?
Chez la partie militante de l’économie collaborative, on trouve l’idée que l’entrepreneuriat peut être un outil pour changer le monde. Il y règne aussi une foi prométhéenne dans la technologie, alliée à l’innovation sociale. Derrière, il y a une croyance dans la décentralisation, dans le pouvoir de l’individu dans sa connexion directe avec les autres pour monter des projets, loin des grandes entreprises, des partis ou des bureaucraties. On y trouve une résurgence de l’autogestion des années 1970, mais galvanisée par les avancées technologiques.
Cette philosophie, qui est manifeste en France au sein du réseau Oui Share, coïncide avec l’émergence d’une pensée du « vivre autrement », et du « travailler autrement ». Le travail, pour les membres de ce mouvement, doit offrir une perspective autre que la maximisation de la valeur pour les actionnaires, s’affilier à un projet de bien commun, être porteur de sens et de créativité.
Simultanément, ce mouvement est loin de s’inscrire contre l’économie de marché. Il est ambigu, tout en dessinant, à sa façon, une perspective de proudhonisme du XXIe siècle. En outre, si ces modèles de start-up se sont définis contre les institutions traditionnelles, ce mouvement entrepreneurial reste en France proche des pouvoirs publics, qui soutiennent économiquement ce secteur, via des incubateurs ou BPIFrance (Banque publique d’investissement).
Vous constatez aussi que cette économie est, finalement, assez élitiste. Et que malgré cette éthique du partage, elle creuse le fossé entre ceux qui contribuent à ce mode de consommation et les autres.
Cette économie est portée par des élites et des créatifs culturels. Les entrepreneurs sont souvent des diplômés des grandes écoles ou de filières universitaires d’élite – alors que, jusqu’à il y a peu, les créateurs de petites entreprises étaient plutôt des non-diplômés. Il s’agit d’un mouvement qui a été initié et qui est prisé d’abord par des couches urbaines diplômées, qui sont sensibles à l’imaginaire romantique d’un mode de vie combinant valeurs écologiques, activités collaboratives, goût pour l’innovation et l’entrepreneuriat.
Ces gens, qui sont à l’aise dans ce projet californien et l’univers numérique, voyagent, parlent plusieurs langues. Pour eux, « la terre est plate », comme dirait Thomas Friedman. C’est en fait une base culturellement étroite. Et pour y réussir professionnellement, il faut être très compétitif, il faut de l’entregent, des réseaux. C’est une économie du Far West, du winner takes it all : celui qui gagne remporte toute la mise et laisse les autres sur le carreau.
Mais aujourd’hui, toute une partie de la population se méfie, voire se montre très hostile vis-à-vis de ce type de services. En particulier, les générations âgées et les couches populaires − même si elles sont adeptes de certains de ses aspects, comme le Bon Coin. Participer à la consommation collaborative suppose un certain rapport au monde, l’adhésion à un modèle culturel qui ne va pas de soi.
En creusant de nouvelles inégalités, cette économie collaborative a donc les mêmes travers que l’économie numérique dans son ensemble ?
L’économie numérique – dont le secteur collaboratif est un pan – porte en germe des inégalités abyssales, qui décuplent encore celles liées à l’éducation. Elle génère une série d’emplois peu qualifiés et avec des statuts peu protecteurs. Pour s’y insérer, il faut, outre les diplômes, moult atouts culturels et psychologiques, qui touchent à la présentation de soi, l’aptitude à se mouvoir dans un univers compétitif… Cela laisse beaucoup de monde sur le bord de la route. Et suppose, collectivement, un effort éducatif gigantesque.
Finalement, ces modèles collaboratifs posent une question : sont-ils soutenables sur le long terme, ou relèvent-ils d’abord de l’expérimentation sociale soutenue par du capital-risque ? En fait, ces modèles, qui créent des richesses mais aussi de fortes inégalités, sont peu inclusifs. C’est ce qui explique que l’on soit passé en peu d’années d’une cyberbéatitude à une cyber-angoisse. Et que, de toutes parts, apparaissent des questionnements sur la finalité de ce système et sur les régulations à inventer.
Monique Dagnaud sera l’invitée du « Monde » lors d’une conférence sur la ville des millennials, vendredi 2 février de 8 h 30 à 10 h 30. Inscriptions ici.